« Dieu cinématique | Page d'accueil | Le château de Boukovsky »
mardi, 07 avril 2015
Jérôme Leroy : « 95% des livres sont inoffensifs »
Article initialement publié sur Le Comptoir
Depuis vingt-cinq ans, l’œuvre au noir de Jérôme Leroy se déploie sur une dizaine d’ouvrages traversés par des tueurs cinéphiles, des ordures politiques, des poètes subversifs, des éclats de violence désespérée et une ivresse conjuguée du vin, de l’amour et du beau style. À l’occasion du festival Quais du Polar, à Lyon, où son dernier roman, « L’Ange gardien », a reçu le Prix des lecteurs, nous avons rencontré ce hussard de gauche entre deux séances de dédicaces.
Dans La Chartreuse de Parme, Stendhal écrit : « La politique dans une œuvre littéraire, c’est un coup de pistolet au milieu d’un concert, quelque chose de grossier et auquel pourtant il n’est pas possible de refuser son attention. » Dans L’Ange gardien, vous affirmez qu’écrire des romans noirs, c’est parler de son temps. En quoi ce genre littéraire est-il le plus à même de mettre le nez du lecteur dans le réel ?
 Pour une raison bien simple, qui tient de l’ADN du roman noir qui a commencé, pour aller vite, en 1929 avec La Moisson rouge de Dashiell Hammet, au moment de la Grande Dépression. C’est une littérature qui s’intéresse essentiellement aux contractures présentes dans le corps social. Elle est ainsi plus à même de coller au réel car elle est l’héritière de deux choses. Tout d’abord, la tragédie classique : par rapport au roman policier, le roman noir est une tragédie, on en connaît la fin, le monde va mal. Elle est également l’héritière du roman réaliste du XIXe siècle – des Misérables de Victor Hugo aux romans d’Eugène Sue – qui fait entrer toute une catégorie de la population (ces fameuses « classes dangereuses ») dans le roman, donc toute une catégorie de problèmes qui vont avec.
Pour une raison bien simple, qui tient de l’ADN du roman noir qui a commencé, pour aller vite, en 1929 avec La Moisson rouge de Dashiell Hammet, au moment de la Grande Dépression. C’est une littérature qui s’intéresse essentiellement aux contractures présentes dans le corps social. Elle est ainsi plus à même de coller au réel car elle est l’héritière de deux choses. Tout d’abord, la tragédie classique : par rapport au roman policier, le roman noir est une tragédie, on en connaît la fin, le monde va mal. Elle est également l’héritière du roman réaliste du XIXe siècle – des Misérables de Victor Hugo aux romans d’Eugène Sue – qui fait entrer toute une catégorie de la population (ces fameuses « classes dangereuses ») dans le roman, donc toute une catégorie de problèmes qui vont avec.
À la question « à quoi sert la littérature ? », vous répondiez « À blasphémer. Le blasphème est la seule fiction qui puisse dépasser la réalité. » Là, il ne s’agit plus de coller au réel mais de le gifler, de faire, comme vous dites, « le beau travail du négatif, celui qui bouleverse, détruit, sape toutes les certitudes politiques et morales d’une société ». Mais cela suppose que la littérature soit intrinsèquement subversive alors que, concrètement, beaucoup de livres sont inoffensifs.
Bien sûr, je crois que 95% des livres sont inoffensifs. Le travail du négatif est essentiellement l’œuvre du roman noir et d’une certaine forme de pensée radicale. Les deux éditeurs français auxquels je fais confiance dans ce domaine sont La Fabrique et la collection Série noire de Gallimard. À ce titre, l’idée de blasphème, de sabotage, de l’écrivain qui apporte des mauvaises nouvelles, provient de mon influence, revendiquée, pasolinienne.
Par ailleurs, j’admire des écrivains de droite parce qu’ils ont une certaine façon d’être dans le style, dans une légèreté, une insolence vis-à-vis des institutions. C’est quand vous êtes minoritaire que vous êtes insolent. Dans un paysage d’après-guerre dominé par la gauche communiste très « stal bas-du-front » (à part Aragon et Roger Vailland), Sartre et l’engagement obligatoire, et le nouveau roman qui chassait le sujet, des écrivains comme Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent ou Michel Déon étaient des respirations et ils le sont toujours. Il en va de même avec A.D.G. dans le polar, car il mérite qu’on se souvienne de lui.
Par votre envie de raconter des histoires, noires de préférence, on imagine que vous ne portez pas l’autofiction dans votre cœur…
Je n’ai aucun mépris pour l’autofiction. Il se trouve que mes premiers romans étaient très autobiographiques, comme souvent chez les jeunes auteurs. Car le roman est un moyen de faire le point sur sa vie au moment où, pour le dire vite, on devient un adulte. Il se trouve que par le fait d’avoir été prof en ZEP à Roubaix pendant plus de vingt-deux ans, je me voyais mal raconter mes histoires de nombril ou de mélancolie amoureuse de trentenaire. Je regardais mes élèves et je me demandais comment tout ça pouvait tenir. Mon premier roman noir, Monnaie bleue, a justement été écrit en 1997 en faisant le constat d’une explosion sociale imminente, que cela ne pouvait pas tenir. On connaît la suite avec les émeutes de 2005…
Un écrivain de gauche qui regrette certains aspects du monde d’avant, se remémorant avec émotion le parfum des librairies, les films de la nouvelle vague, les yé-yé, écrivant dans des journaux de droite, et fustigeant la laideur et la mécanisation des rapports humains actuels, court le « risque » de se faire taxer de rouge-brun par des anti-fascistes d’opérette. Comment assumez-vous cette apparente contradiction ?
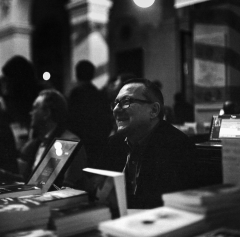 Je me sens toujours, historiquement et politiquement, l’héritier de quelque chose qui n’a jamais existé en tant que tel de manière constitué mais qui, de fait, a régné sur la France durant une des périodes les plus heureuses de sa vie : le gaullo-communisme. Au gaullisme, la politique étrangère, les grandes décisions internationales ; au communisme, une certaine common decency et une émancipation de la population au niveau local. Il me semble que cela fonctionnait parfaitement dans la période des Trente Glorieuses.
Je me sens toujours, historiquement et politiquement, l’héritier de quelque chose qui n’a jamais existé en tant que tel de manière constitué mais qui, de fait, a régné sur la France durant une des périodes les plus heureuses de sa vie : le gaullo-communisme. Au gaullisme, la politique étrangère, les grandes décisions internationales ; au communisme, une certaine common decency et une émancipation de la population au niveau local. Il me semble que cela fonctionnait parfaitement dans la période des Trente Glorieuses.
Par ailleurs, j’ai un axiome qui a l’air d’une formule, mais qui n’en est pas une : je ne dis pas que c’était mieux avant, je dis que c’est pire maintenant. C’est toute la nuance. On n’arrive pas à prendre en compte le fait que, depuis deux générations, on vit moins bien que les générations précédentes alors que nous sommes dans un système qui produit de plus en plus, et parfois de manière délirante et dangereuse pour la planète, des richesses. Ce hiatus est insoutenable. Alors, on peut me traiter de tout ce qu’on veut mais dès que je peux m’exprimer librement dans une tribune, je le fais. Ce qui est le cas de Causeur. On peut reconnaître des tas de défauts à Causeur mais il a au moins une qualité, c’est qu’on peut exprimer, même si je suis minoritaire, sa contestation par rapport à ce qui y est dit.
Une expression revient souvent sous votre plume pour qualifier notre société, celle de « Disneyland préfasciste ». Est-ce à dire que la société capitaliste a réussi, ou est en passe de réussir, la fusion de l’ordre et de l’infantilisation au service de la consommation de masse ?
Voilà, je ne sais pas ce que je pourrais ajouter. C’est une société qui, par exemple, nous abrutit de télé-réalité depuis des décennies. Comment voulez-vous qu’un peuple, dans une situation économique difficile, réagisse politiquement, normalement, quand il a été soumis au Bigdil et aux Ch’tis à Ibiza ? Il y a un abêtissement du peuple par le divertissement le plus vulgaire, le plus aliénant. On est loin de la culture qui émancipe.
La poésie est-elle un remède à ce « Disneyland préfasciste » par sa beauté, son inutilité, sa subversion ? Et ce, même si elle a mauvaise presse, généralement considérée comme une pratique culturelle élitiste et bourgeoise ?
 On a une double représentation fausse de la poésie. On me demande souvent si la poésie est une manière de me détendre par rapport au roman noir, eh bien non, car le poète et l’auteur de roman noir ont en commun de vouloir regarder le réel sous un angle différent. Il y a aussi les représentations, liées à la scolarité, qu’on se fait de la poésie, à laquelle on donne comme synonyme le lyrisme, c’est-à-dire les petites fleurs, la beauté, etc., alors que Rimbaud, dans le prologue d’Une saison en enfer, injuriait déjà la Beauté assise sur ses genoux. Malheureusement, cette représentation est très dominante et elle répond à une autre représentation, celle d’une poésie élitiste, faite par des poètes universitaires posant, de manière expérimentale, trois mots par phrases, trois phrases par page… Or, il existe une poésie du quotidien, dont les Américains nous ont montré la voie, à l’exemple de Charles Bukowski ou Raymond Carver. C’est toute la différence, et le génie, entre décrire la vie d’une femme seule dans un bar dans un roman réaliste et en faire un poème. On pourra employer les mêmes mots (Coca-Cola, barman, mégot écrasé…) mais tout d’un coup, cela deviendra un poème. Dans mon cas, il s’agit de raconter des histoires violentes, mais de savoir respirer avec la poésie.
On a une double représentation fausse de la poésie. On me demande souvent si la poésie est une manière de me détendre par rapport au roman noir, eh bien non, car le poète et l’auteur de roman noir ont en commun de vouloir regarder le réel sous un angle différent. Il y a aussi les représentations, liées à la scolarité, qu’on se fait de la poésie, à laquelle on donne comme synonyme le lyrisme, c’est-à-dire les petites fleurs, la beauté, etc., alors que Rimbaud, dans le prologue d’Une saison en enfer, injuriait déjà la Beauté assise sur ses genoux. Malheureusement, cette représentation est très dominante et elle répond à une autre représentation, celle d’une poésie élitiste, faite par des poètes universitaires posant, de manière expérimentale, trois mots par phrases, trois phrases par page… Or, il existe une poésie du quotidien, dont les Américains nous ont montré la voie, à l’exemple de Charles Bukowski ou Raymond Carver. C’est toute la différence, et le génie, entre décrire la vie d’une femme seule dans un bar dans un roman réaliste et en faire un poème. On pourra employer les mêmes mots (Coca-Cola, barman, mégot écrasé…) mais tout d’un coup, cela deviendra un poème. Dans mon cas, il s’agit de raconter des histoires violentes, mais de savoir respirer avec la poésie.
En quoi la lecture de Guy Debord a-t-elle été décisive dans votre perception critique de la politique ?
Elle a été majeure. Il y avait chez Debord ce que j’avais lu, une dizaine d’années plus tôt, dans les romans de science-fiction, notamment ceux de Philip K. Dick qui mettaient en question la réalité, ce sentiment de vivre dans des décors truqués. Tout d’un coup, je lis Debord, que je découvre en 1988 lors de la parution des Commentaires sur la société du spectacle, et c’est fondamental. De même qu’a été fondamentale, à la même époque, la lecture de Cool Memories de Jean Baudrillard, dans cette recherche de la nature même du réel. D’un point de vue superficiel, cela permet d’alerter sur les manipulations médiatiques et politiques mais, dans ce que Debord nomme la « séparation », cela induit des modes de vie entiers et généralisés qui nous rendent spectateurs de notre propre vie.
Moi qui suis amateur de littérature fantastique, j’ai remarqué que dans les années 1980, la créature à la mode était le vampire, qui correspondait à l’angoisse du sida, du sang, du corps ; alors que ce qui revient à la mode aujourd’hui, depuis 2008 serais-je tenté de dire, c’est le zombie. Chez George Romero, le zombie est la figure ultime du consommateur, l’individu qui ne réagit plus, fonctionnant uniquement par des stimuli. Enfin, la troisième révélation, après Debord et Baudrillard, fut Baudouin de Bodinat qui, dans La Vie sur terre, fait allusion à John Brunner, K. Dick, etc., c’est-à-dire des auteurs de littérature populaire qui décrivent ce monde en perte de sa propre réalité.
Votre recueil Dernières nouvelles de l’enfer rend directement hommage aux films de séries B, tels que ceux de Romero, John Carpenter, John Landis, etc.
C’est amusant, car à l’origine ces textes étaient prévus comme livrets dans une collection DVD de films d’épouvante, et devaient donc tous faire la même longueur. Chaque nouvelle faisant écho à un film, des Griffes de la nuit à Blade Runner (qui n’a rien d’un film d’horreur mais qui est un grand film), en passant par Vendredi 13 et Dracula.

Les consommateurs pendant les soldes selon Romero
Le cinéma constitue ainsi une part importante de vos références. Est-ce un simple hommage aux films d’une époque révolue ou cela vous permet-il de construire vos romans selon une mise en scène propre au cinéma ?
Que ce soit pour le cinéma ou la littérature, j’estime que le genre est, sur un plan technique, une formidable école de narration. On a un peu oublié qu’il faut savoir raconter des histoires. Et on a beau mépriser le succès d’un Marc Lévy ou d’un Guillaume Musso, car c’est certes inintéressant, ils savent tout de même raconter des histoires. C’est ça la clé du roman populaire, depuis Alexandre Dumas ou Eugène Sue. Ensuite, à nous d’investir ces formes-là pour en faire quelque chose d’un peu subversif. Par exemple, le personnage du tueur en série ne m’intéresse que s’il fait valoir ses droits à la retraite ou que Wall Street est une des portes de l’Enfer. Pourtant, je ne suis pas le premier à faire ça. Romero, encore lui, dans ses deux premiers films, utilise la figure du zombie comme critique politique. La Nuit des morts-vivants est le plus grand film anti-ségrégationniste, et Zombie est une satire féroce du consommateur qui continue à faire ses courses même mort.
Personne ne vous a jamais proposé d’adapter l’un de vos romans au cinéma ?
Il y a deux options sur Le Bloc et une sur L’Ange gardien. Mais pas plus pour l’instant.
Dans Monnaie bleue, vous écrivez que les deux choses qui rendent la vie supportable sont le plaisir et l’art. Diriez-vous que cela rejoint les deux seules choses essentielles pour Orwell, selon Simon Leys, à savoir le frivole et l’éternel ?
 Monnaie bleue est un roman de 1997, donc je formulerais cette devise sans doute autrement aujourd’hui. Bien sûr, j’ai un tempérament extrêmement nostalgique et les seules choses qui me consolent sont les plaisirs de la vie, l’art en général, la littérature et la poésie en particulier. Les vraies dystopies sont celles où l’art est éradiqué. Le vrai cauchemar, c’est Fahrenheit 451.
Monnaie bleue est un roman de 1997, donc je formulerais cette devise sans doute autrement aujourd’hui. Bien sûr, j’ai un tempérament extrêmement nostalgique et les seules choses qui me consolent sont les plaisirs de la vie, l’art en général, la littérature et la poésie en particulier. Les vraies dystopies sont celles où l’art est éradiqué. Le vrai cauchemar, c’est Fahrenheit 451.
Seriez-vous d’accord pour reprendre, en la paraphrasant, l’affirmation d’Orwell qui déclarait en 1946 dans Pourquoi j’écris : « Tout ce que j’ai écrit d’important, chaque mot, chaque ligne, a été écrit, directement ou indirectement contre le totalitarisme libéral et pour le communisme tel que je le conçois » ?
Orwell est un génie mais je me pose toujours la question de savoir comment cette pensée peut être récupérée par la droite la plus réactionnaire. Par exemple, sans être un lecteur naïf, quand je lis 1984, je lis une critique de notre société avancée, libérale, promouvant la semaine de la Haine, fliquant ses citoyens et diffusant sa propagande médiatique. C’est comme les gens qui me disent : « Ah, les communistes, c’est bien les bulldozers à Vitry-sur-Seine contre les Arabes. » Les gens adorent les communistes quand ils ne se comportent pas comme des communistes. Il faut se méfier car il y a beaucoup de gens de droite qui se revendiquent du socialisme au nom de la décroissance, alors que nous avons des intérêts et des visions extrêmement divergentes, notamment concernant l’émancipation individuelle et collective. Il y a un travail idéologique à mener à la gauche de la gauche car l’alliance du « vivant » entre Les Veilleurs et les faucheurs d’OGM pose problème. Il y a d’un côté la bourgeoisie qui se sert de son catholicisme pour critiquer le monde moderne, ce qui peut plaire à des gens de gauche qui s’aperçoivent (même moi en tant que communiste « orthodoxe ») qu’on est dans une forme d’impasse productiviste. Mais, entre les deux, on peut discuter un peu et tracer des lignes de partage. Car si ça continue comme ça, il y aura un portrait d’Orwell au Medef. La captation de l’héritage d’Orwell par les néo-réacs commence à m’agacer fortement.

Paul Signac, "Au temps de l'anarchie"
Encore que votre conception du communisme est assez loin du goulag soviétique, même si on sent que ça ne vous déplairait pas d’en déporter certains : vous prônez/rêvez un communisme balnéaire. La révolution en surfant ?
Dans un certain sens, je me base sur un ouvrage paru en 2002, Sur la plage : mœurs et coutumes balnéaires aux XIXe et XXe siècles, du sociologue Jean-Didier Urbain. En somme, quand on sera vraiment libéré des contraintes de production, la société idéale pourrait ressembler à une plage grecque ou bretonne, sans surpopulation, où les gens discuteraient au calme, se prélassant au soleil, laissant leurs enfants jouer tranquillement…
Je voudrais réenchanter, au moins littérairement, le mot « communisme » qui, à force de propagande capitaliste et à cause du désastre stalinien, a fini par ressembler à la caricature énoncée par OSS 117 : une dictature où les gens ont froid, portent des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. Je souhaite associer le communisme à une idée radieuse qui ressemble davantage à la peinture de Paul Signac, Au temps de l’anarchie.
Quel livre offririez-vous à une fille pour la séduire ?
La Fête de Roger Vailland. C’est un roman où un type propose à une jeune fille de s’enfermer pendant trois jours dans un hôtel à la campagne, après avoir fait la course en bagnole à bord d’une 404.
Sylvain Métafiot
Photos © Julien Chambon
Nos Desserts :
- Le blog de Jérôme Leroy : Feu sur le quartier général !
- Les articles de Jérôme Leroy sur Causeur
- Jérôme Leroy est également l’auteur de poésies et d’un essai consacré à Frédéric Fajardie
- La Poétique subversive des hussards, par Petr Kylousek
- Vidéo Commentaires sur la société du spectacle de Guy Debord
- La Vie sur terre de Baudouin de Bodinat
- Apocalypse zombie : « Fin du monde et morts-vivants chez Romero », conférence de Philippe Rouyer
- Le frivole et l’éternel selon George Orwell
- Le site du photographe Julien Chambon
19:05 Publié dans Littérature | Tags : 95% des livres sont inoffensifs, blasphème, cinéma de genre, communisme balnéaire, dernières nouvelles de l'enfer, disneyland préfasciste, george romero, guy debord, jérôme leroy, john carpenter, julien chambon, l'ange gardien, le bloc, le comptoir, littérature, lyon, monnaie bleue, orwell, paul signac, poésie, quais du polar, roman noir, série noire, sylvain métafiot | Lien permanent | Commentaires (0)










Les commentaires sont fermés.