« Cinéma : L’Échappée poétique d’Annie Le Brun | Page d'accueil | 13 novembre 2015 – le soir des grands perdants »
mardi, 03 novembre 2015
La vanité des lettres : L’Écrivain raté de Roberto Arlt
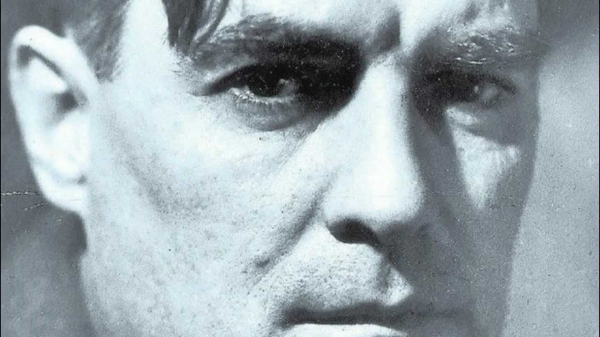
Il est des livres que l’on ne conseillerait pas à des amis écrivains ou aspirants à l’être, sous peine de risquer à les paralyser dans leur travail. L’Écrivain raté de Roberto Arlt est de ceux-là. Non pas qu’il puisse bloquer toute volonté d’écrire à la manière des chefs-d’œuvre de la littérature : devant des pages superbes on réévalue douloureusement son « talent » à la baisse. Le poids des génies du passé est ici évoqué (« Il te semble logique de penser que nous, êtres minuscules, pourrons surpasser ce qu’eux ont si parfaitement achevé ? ») mais l’écrivain argentin fait surtout preuve d’un féroce humour noir pour montrer la futilité d’écrire, l’absurdité d’y consacrer sa vie, le dégoût du milieu littéraire. Désespérant ? Oui mais infiniment drôle quant à la description de ce parcours en nullité exaltée.
L'art de la chute
Pourtant, le jeune auteur qui nous raconte ses malheurs a débuté par un coup de génie, une œuvre époustouflante, applaudie par la critique, adoubée par ses pairs et réclamée par le public : « Des trompettes d’argent exaltaient ma gloire dans les murs de la ville grossièrement badigeonnée et les nuits, dans mes yeux, se paraient d’un prodige antique, connu de personne. » C’est après que les choses se gâtent : plus d’inspiration ! Les idées, envolées. La motivation, désertée. Le talent évaporé. Pourquoi, comment, par quelle malédiction le feu s’est-il transformé en glace ? Nul ne le sait, lui encore moins. La gloire était advenue trop vite, les éloges furent trop flatteurs. La chute du petit paradis mondain n’en fut que plus douloureuse : « Comprenez-vous l’horreur d’une telle situation ? Deux ans, sans rien écrire. Se proclamer auteur, avoir promis monts et merveilles à ceux qui prenaient la peine de nous écouter et se trouver si vite, à brûle-pourpoint, avec la conscience d’être incapable de rédiger une ligne originale, d’accomplir quelque chose qui justifie le prestige résiduel. Comprenez-vous bien combien s’avère blessante cette infâme question de prétendus amis qui, s’approchant de nous, disent sur un ton naïf où transparaît indéniablement une malignité satisfaite : – Pourquoi ne travailles-tu pas ? ou bien : Quand est-ce que tu publies quelques chose ? »
Par dépit envers sa propre impuissance et par rancœur envers le talent de ses compagnons, il décide de se lancer, par cynisme exacerbé, dans la réalisation d’une grande œuvre négative, un « Décalogue de la non-action ». Un sursaut mensonger auquel il ne réussit pas à croire lui-même et qui mue en un club des non-écrivains sous le prétexte d’une nouvelle exigence divine. Il y a trop de textes, déclare-t-il ! Stop aux cadences infernales des grattes-papiers professionnels qui encombrent les librairies et les étagères particulières de leur insipide prose ! Sous le noble but de sauver l’art, la Loge des Exigeants rallie à sa cause de jeunes arrogants qui sèment la terreur chez les besogneux : « La thèse prospéra, devint un précepte. Beaucoup de crétins se mirent à respecter ma position spirituelle. […] Vous penserez que je mens, mais plusieurs individus qui préparaient des chefs-d’œuvre, interrompirent leur dur labeur aux cris de : – À bas les pondeuses de la littérature ! »
 L’exigence bien comprise commençant par soi-même le narrateur, dans une incessante introspection psychologique, ressasse sa gloire passée comme justification de son inactivité : « Je détestais le bonheur des simples et des ingénus, et simultanément je cherchais leur compagnie, comme si eux, et eux seulement, pouvaient penser l’ulcère de mon mépris, déversant toujours son pus d’égotisme, une pourriture de venin dynamite. Avec cette croissance de la vanité, mon orgueil aussi redoubla, et je me jugeai intouchable, statue de marbre blanc sur laquelle c’était pécher que de projeter une ombre. Je tournai les yeux vers mon Œuvre réalisée il y avait bien longtemps et je la proclamai parfaite, impeccable. À qui voulait l’entendre, j’expliquais que seul le respect de ma création antérieure m’empêchait de produire quelque chose de nouveau qui ne soit pas plusieurs fois supérieur à elle. Et la surpasser… il était si difficile de la surpasser… »
L’exigence bien comprise commençant par soi-même le narrateur, dans une incessante introspection psychologique, ressasse sa gloire passée comme justification de son inactivité : « Je détestais le bonheur des simples et des ingénus, et simultanément je cherchais leur compagnie, comme si eux, et eux seulement, pouvaient penser l’ulcère de mon mépris, déversant toujours son pus d’égotisme, une pourriture de venin dynamite. Avec cette croissance de la vanité, mon orgueil aussi redoubla, et je me jugeai intouchable, statue de marbre blanc sur laquelle c’était pécher que de projeter une ombre. Je tournai les yeux vers mon Œuvre réalisée il y avait bien longtemps et je la proclamai parfaite, impeccable. À qui voulait l’entendre, j’expliquais que seul le respect de ma création antérieure m’empêchait de produire quelque chose de nouveau qui ne soit pas plusieurs fois supérieur à elle. Et la surpasser… il était si difficile de la surpasser… »
L’inertie inactive de sa petite secte de récalcitrants finit néanmoins par le lasser. Les coups de poing dans le vide devinrent puériles : « L’homme finit par se fatiguer de tout, même de cracher à la figure de son prochain. Il faut convenir ici que nos insultes procédaient d’une bonne intention, mais il n’est pas possible d’être généreux éternellement, et nous nous dispersâmes. » N’ayant rien produit durant cette entreprise de bastonnade littéraire, sa tristesse s’accroît, son orgueil enfle. S’ils savaient, tous ces parasites, le génie qui m’habite, la puissance du verbe qui demeure tapie au fond de moi ! Ma voix est la seule qui mérite d’être entendue, la plus limpide, la plus parfaite. Quel dommage que mon talent ne refasse pas surface : « Je ne suis pas un type psychologique fait pour vivre dans une silencieuse médiocrité. Le génie, la beauté, l’art, constituent pour moi un déguisement, destiné à dissimuler les dimensions réduites de mon intelligence, qui à son tour repose sur la structure d’une vanité incommensurable. »
Logique de l’incohérence
Exaspéré par l’échec, son désespoir se transforme en haine pour ses contemporains. Il s’improvise logiquement critique littéraire afin de démolir le travail d’autrui (tous les journalistes littéraires ne sont-ils pas des écrivains ratés?) : « Rien ne parvenait à me plaire. Comme une vitre sale, j’appauvrissais la clarté la plus radieuse. […] Je découvrir en moi l’âme de l’inquisiteur. » Prenant un malin plaisir à jouir des livres qu’il détruit dans ses articles son but est d’attirer l’attention du landerneau des lettres. Mais le jeu ne prend pas. Aucune lettre d’insultes n’arrive sur son bureau, aucun duel n’est jamais provoqué. L’intérêt qu’il suscite confine au néant. Sa rage redouble : « Il y eut des moments où je rêvais que tous les écrivains aient une seule tête. Quelle joie alors de détruire cette tête unique à coups de marteau, ouvrir une fosse, ouvrir une fosse dans n’importe quel désert, enterrer bien profondément cette masse humaine et s’exclamer à gorge déployée : – La littérature n’existe plus. Je l’ai tuée pour toujours ! »
Suivant le sens du vent, il se prend pour un révolutionnaire, daignant prendre parti, du haut de sa grandeur incomprise, pour la cause du peuple : « Comme certains de mes compagnons, je voulus me rapprocher de la classe laborieuse. Je ne nierai pas avoir cru qu’en assumant une telle attitude je faisais une extraordinaire faveur au prolétariat. » Mais de la même façon qu’il fut excommunié par l’archevêque, les ouvriers refusèrent de lui servir de caution vertueuse, dévoilant l’artifice de sa posture, lui qui regardait les petites gens d’un œil hautain perché sur des cimes invisibles : « Je déclare fièrement que j’ai toujours méprisé le public ; mais, comme il faut civiliser le petit peuple et que nous, les dieux, ne pouvions rester continuellement dans les hauteurs sous peine de nous dégonfler, nous condescendîmes à nous intéresser aux masses et à leur donner des nouvelles de nos découvertes dans le monde de la beauté. Cependant, le public (l’éternelle brute) persista à ne pas nous lire, à ignorer notre existence. »
Changeant une nouvelle fois d’attitude, il se met en tête de ne plus s’informer du tout, teintant son échec d’une imperturbable indifférence aux affaires du monde. Puis, son indifférence tourne à l’acclamation forcenée de tout et de rien et donc à un mépris indifférencié et plat de tout ce qui est. Là encore, le désir d’attirer l’attention tourne court. Personne ne prête le moindre regard à son agitation effrénée. Et devant la déficience totale de son œuvre, l’évidence lui saute au visage : « Je suis un bourgeois égoïste. Je le reconnais. De là vient que rien n’arrive à m’indigner sérieusement. Ni le bon ni le mauvais. Je n’ai pas non plus la soif d’éblouir mon prochain. Si j’ai dit quelque part que je souffrais quand je ne pouvais pas écrire, c’était un mensonge. Je me suis écarté de la vérité pour orner ma personnalité d’un attribut qui puisse la rendre intéressante. »
La haine de soi comme remède à l’amour-propre
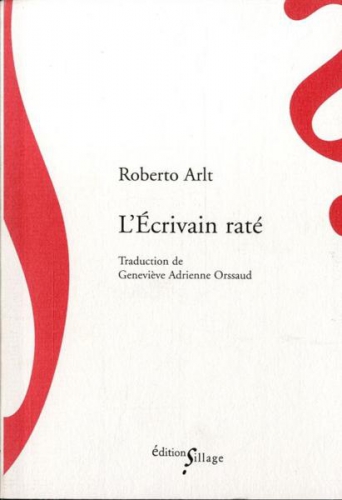 À ce portrait acide dénudant ses propres névroses, Roberto Arlt aurait pu écrire une suite visant l’envers de l’écrivain, son double intime : le lecteur. Il aurait pu s’appeler Le Lecteur apathique (ou boulimique), et nombre de bibliophages s’y seraient reconnus avec crainte et délectation. Giovanni Papini avait déjà esquissé pareil portrait dans Gog où il interpellait cruellement le lecteur, c’est-à-dire à lui-même : « Ne te paraît-elle pas misérable, cette vie, et ne paraît-il pas petit, ce monde ? Voilà ce que je voudrais te demander, ô très vil lecteur, nabot aveuli qui reste là à lire des pages, à écouter des battements de vie d’autrui, parce que tu ne sais pas accomplit d’actes, parce que tu ne sais pas vivre pour ton propre compte. Cela ne te paraît pas vil, lâche, très lâche ? Un siège t’accueille, devant toi il y a des feuilles cousues, sur ses feuilles il y a des signes noir, et tu parcours ses signes des yeux et ta petite âme sourit ou pleurniche, voit ou entrevoit, selon que les signes finissent par éveiller tes images somnolentes. Et tu crois vivre, je crois, en lisant des livres. En sortant tu regarderas avec un mépris infini le bas peuple qui n’est pas intellectuel, qui ne fait pas de psychologie et ne se nourrit pas de littérature. »
À ce portrait acide dénudant ses propres névroses, Roberto Arlt aurait pu écrire une suite visant l’envers de l’écrivain, son double intime : le lecteur. Il aurait pu s’appeler Le Lecteur apathique (ou boulimique), et nombre de bibliophages s’y seraient reconnus avec crainte et délectation. Giovanni Papini avait déjà esquissé pareil portrait dans Gog où il interpellait cruellement le lecteur, c’est-à-dire à lui-même : « Ne te paraît-elle pas misérable, cette vie, et ne paraît-il pas petit, ce monde ? Voilà ce que je voudrais te demander, ô très vil lecteur, nabot aveuli qui reste là à lire des pages, à écouter des battements de vie d’autrui, parce que tu ne sais pas accomplit d’actes, parce que tu ne sais pas vivre pour ton propre compte. Cela ne te paraît pas vil, lâche, très lâche ? Un siège t’accueille, devant toi il y a des feuilles cousues, sur ses feuilles il y a des signes noir, et tu parcours ses signes des yeux et ta petite âme sourit ou pleurniche, voit ou entrevoit, selon que les signes finissent par éveiller tes images somnolentes. Et tu crois vivre, je crois, en lisant des livres. En sortant tu regarderas avec un mépris infini le bas peuple qui n’est pas intellectuel, qui ne fait pas de psychologie et ne se nourrit pas de littérature. »
Écrivain ou lecteur, le triste constat est aujourd’hui le même : l’accumulation exponentielle de la médiocrité graphique oblige à une drastique sélection. Environ 600 livres sont publiés chaque année lors de la « traditionnelle » rentrée littéraire de septembre. Combien de ratés dans le lot ? Combien de péroreurs médiatiques s’évertuent à vendre leur œuvre dans une tornade de fatuité ? Combien de scandales ridicules sur les plateaux télés ? Combien de compromissions dégradantes ? Combien oseraient avouer dans un éclair de lucidité, à l’instar de l’écrivain de Roberto Arlt : « Je n’avais rien à dire. Le monde de mes émotions était petit. Là était la vérité. Mon esprit n’était pas en contact avec les intérêts et les problèmes de l’humanité ni avec la vie des hommes qui m’entouraient, mais avec des ambitions personnelles dénuées de valeur. »
Débordant d’amour pour leur propre plume certains d’entre eux mériteraient une bonne cure d’humilité afin de les désintoxiquer de leur dépendance égotique. Et ce ne serait pas la moindre des qualités de ce livre que de freiner cette épidémie.
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Gazettarium
14:00 Publié dans Littérature | Tags : absurdité, argentine, club des non-écrivains, critique littéraire, décalogue de la non-action, fatuité, inspiration, l'écrivain raté, la vanité des lettres, motivation, rentrée littéraire, roberto arlt, sylvain métafiot, talent, gazettarium | Lien permanent | Commentaires (0)










Écrire un commentaire