« Pièce et Main-d'Oeuvre : "La fabrication de post-humains créera deux espèces d'humanité." | Page d'accueil | Priape va à l’école : Petit Paul de Bastien Vivès »
mercredi, 31 octobre 2018
Bernard Benoliel : « “Taxi Driver” se nourrit de la folie criminelle des seventies »

Article initialement publié sur Le Comptoir
Directeur de l’action culturelle et éducative à la Cinémathèque française, ancien critique aux « Cahiers du cinéma » et auteur d’ouvrages sur Clint Eastwood et Bruce Lee, Bernard Benoliel a consacré un essai au cinquième long-métrage de Martin Scorsese : « Taxi Driver » (Yellow Now, 2017). Film fournaise marqué au fer rouge du Nouvel Hollywood qui, au cœur d’une décennie agitée de bouillonnements contestataires au sein de laquelle les œuvres de Friedkin, Polanski ou Altman ont redéfini les codes du film noir, enfièvre les rues de New York d’un hyper-réalisme hallucinatoire, d’une ultra-violence cathartique et d’un dédoublement obsessionnel.
Le Comptoir : Dès l’introduction de votre essai, vous affirmez vouloir prendre à rebours les interprétations communes sur Taxi Driver, en visionnant le film « comme dans un miroir ». Quels sont les commentaires habituellement émis sur le film et pourquoi vouloir s’en départir ?
 Bernard Benoliel : Taxi Driver est un film, à la mesure du choc provoqué à sa sortie et à chaque nouvelle vision, qui a suscité nombre d’analyses, d’interprétations, toute une glose critique très légitime, à la mesure aussi d’un phénomène essentiel : le film demeure pour une part énigmatique, il échappe à qui veut le cerner. Que peut-il bien signifier véritablement et, en particulier, comment comprendre les raisonnements et les actes de Travis Bickle, le personnage du taxi driver joué par Robert De Niro ? De ce point de vue, le film agit comme certains autres, célèbres et célébrés pour cette même raison, ce que la culture populaire appelle des films “cultes”, par exemple Vertigod’Hitchcock ou Mulholland Drive de Lynch, des œuvres avec lesquelles il est impossible d’en finir : « analyse terminée, analyse interminable », écrivait Freud en donnant bien sûr à l’analyse un autre sens qu’ici. En écrivant sur le film de Scorsese et en avançant dans son “analyse”, j’ai éprouvé ce vertige, cette spirale du sens, un vertige euphorisant car il encourage à toujours pousser plus loin, chaque fois le film répondant présent.
Bernard Benoliel : Taxi Driver est un film, à la mesure du choc provoqué à sa sortie et à chaque nouvelle vision, qui a suscité nombre d’analyses, d’interprétations, toute une glose critique très légitime, à la mesure aussi d’un phénomène essentiel : le film demeure pour une part énigmatique, il échappe à qui veut le cerner. Que peut-il bien signifier véritablement et, en particulier, comment comprendre les raisonnements et les actes de Travis Bickle, le personnage du taxi driver joué par Robert De Niro ? De ce point de vue, le film agit comme certains autres, célèbres et célébrés pour cette même raison, ce que la culture populaire appelle des films “cultes”, par exemple Vertigod’Hitchcock ou Mulholland Drive de Lynch, des œuvres avec lesquelles il est impossible d’en finir : « analyse terminée, analyse interminable », écrivait Freud en donnant bien sûr à l’analyse un autre sens qu’ici. En écrivant sur le film de Scorsese et en avançant dans son “analyse”, j’ai éprouvé ce vertige, cette spirale du sens, un vertige euphorisant car il encourage à toujours pousser plus loin, chaque fois le film répondant présent.
Alors oui, dans le préambule du livre, j’ai voulu résumer très vite le sens des commentaires majoritaires sur Taxi Driver, des commentaires qui parfois s’excluent ou s’opposent, ce qui de fait n’est pas étonnant, mais des commentaires qui, à force, ont tendance à figer le film et singulièrement Travis Bickle, un personnage qui se retrouve enfermé dans le tableau des psychoses – un portrait clinique qui encore une fois a sa part de vérité (le film est très “accueillant”) – et un personnage alors devenu seulement le révélateur d’une société déboussolée et criminogène. J’ai voulu assurément “libérer” Travis, le rendre à sa complexité ou à sa dualité.
On a beaucoup écrit aussi de Taxi Driver, sorti en 1976, qu’il faisait, à même le corps et l’âme de Travis – qui arbore plus d’une fois une veste militaire, appartenant au scénariste Paul Schrader –, le portrait d’un vétéran et témoignait d’un trauma d’après-guerre. Et même si Scorsese a déclaré : « Mon film n’est pas un commentaire sur le Vietnam. » De fait, certaines études ont fait de Taxi Driver un exemple patent de la crise de la masculinité en Occident dans les années 1970 quand d’autres ont annexé le même film pour lui faire rejoindre le corpus des vigilante movies, soit l’expression du retour d’une hyper virilité toujours en Occident et toujours à la même période.
De même, le film et le personnage, indissociables, ont beaucoup été lus à l’aune du catholicisme de Scorsese et du protestantisme de Schrader quand le réalisateur et le scénariste, pour leur part, ont souvent qualifié Travis de kamikaze, de samouraï ou de rônin, et même si Scorsese a dit une fois, nous aidant à mon sens à nous mettre sur le chemin du vrai Travis : « Travis, c’est la toute-puissance de l’esprit, mais sur le mauvais chemin. »
« On ne comprend rien à Taxi Driver si on refuse de voir que le film est traversé, travaillé en permanence par un “irréalisme”, un sur-réalisme ou un hyper réalisme qui confine au “gothique”, comme l’exprimait Scorsese, ou au fantastique. »
C’est cette piste que j’ai suivie, celle qui m’a paru la plus féconde et capable de renouveler une approche un peu en boucle du film, aidant à retourner ou renverser le sens, comme notre image s’inverse dans un miroir et comme celle du vrai Travis surgit dans la scène cruciale du miroir de Taxi Driver (« You talkin’ to me ? »). Et c’est précisément ma vision de cette scène névralgique qui m’a donné l’idée de proposer un renversement du sens du film. Ce faisant, il y avait la volonté aussi de rappeler les possibles puissances de l’analyse cinématographique tant je crois à une “politique du film”, à savoir qu’un film est le document primordial et qu’il en sait plus long que son auteur, ou ses auteurs en l’occurrence puisque ici on parle d’une création tricéphale, résultat de la volonté convergente de Scorsese, Schrader et De Niro, tous les trois sur une même longueur d’onde.
Pour la critique Pauline Kael, « Le cinéma s’est emparé de l’âme de cette ville, d’une manière qui va bien au-delà du réalisme. […] On a le sentiment que la violence à l’écran pourrait à tout moment mettre le feu aux poudres dans la salle. Le public est vivant, au risque d’exploser. » Selon vous, Taxi Driver ne pouvait être tourné qu’à New York ?
Le passage important de la citation de Pauline Kael, c’est : « d’une manière qui va bien au-delà du réalisme ». À mon sens, on ne comprend rien à Taxi Driver, ou on en reste au sens habituel, si on refuse de voir que, depuis le début (les vapeurs de fumée de la nuit qui suivent Travis comme une traîne au petit matin de son entretien d’embauche), puis crescendo, le film est traversé, travaillé en permanence par un “irréalisme”, un sur-réalisme ou un hyper réalisme qui confine au “gothique”, comme l’exprimait Scorsese, ou au fantastique. C’est-à-dire que le film accède à une dimension qui le détache d’un réalisme dans lequel il baigne en même temps, un au-delà du réalisme sans lequel les actes de Travis ne seraient qu’horribles, déments et condamnables, et fin de l’histoire. Or, bien avant en fait, mais spectaculairement à partir de la scène du miroir, là où “l’autre” Travis et “l’autre film” s’engouffrent et prennent le dessus, on est dans une dimension de l’être du personnage qui relève justement d’une toute autre dimension, une quatrième dimension où coïncident une hyper morale (par-delà bien et mal) et l’expression métaphorique d’un geste artistique (Travis ou le portrait combiné d’un écrivain, d’un cinéaste et d’un acteur). Pour cela, il ne faut pas s’en tenir à la représentation et à la perception courantes du réalisme ; comme dans le film, il faut aller au-delà.

En cela, la ville de New York, celle des années 1970, aide grandement à dépasser le réalisme ordinaire… C’est une ville alors en faillite et en ébullition, « un égout à ciel ouvert » pour parler comme Travis, une ville dont on ne peut plus avoir l’idée aujourd’hui à l’heure d’une gentrification qui vitrifie tout, une ville d’alors dont les films (Good Time, 2017) et les séries (The Deuce, 2017) d’aujourd’hui s’attachent à retrouver la pulsation en s’inspirant des images et de l’empreinte laissées par Taxi Driver, le lieu unique des noces d’Eros et de Thanatos, « le bal des fous » dixit Pauline Kael, « une cocotte-minute » selon le mot de Schrader, une ville dont Scorsese a pu dire en se rappelant le tournage qu’elle dégageait « une atmosphère, la nuit, qui se répandait comme une sorte de virus. Vous pouviez le sentir dans l’air et en avoir le goût dans la bouche. » Une ville tellement vivante et frénétique qu’elle en devient le lieu de toutes les folies et de toutes les audaces, une ville tellement réelle qu’elle en devient fantastique. Impossible en ce sens d’imaginer le film se dérouler ailleurs qu’à New York bien que les premiers scénarios de Schrader le situaient à Los Angeles, là où l’idée lui est venue, une autre fois à San Francisco. Mais Scorsese, De Niro, le chef opérateur Michael Chapman, sont des new-yorkais de naissance, ils respirent et aspirent cette ville, ils en font sentir l’air irrespirable et enivrant.
« Nourri de son époque et lui présentant en retour le miroir de son écran, Taxi Driver apparaît encadré dans le réel par d’énigmatiques passages à l’acte », écrivez-vous. Et de citer les célèbres Taxi Driver Kids, selon l’expression de Paul Schrader, que sont Charles Whitman, Arthur Bremer, Lynette Fromme, John Hinckley et Lee Harvey Oswald. Peut-on dire que ce film, avec d’autres, canalise l’atmosphère de folie criminelle qui flotte dans les années 1970 ?
Le film canalise une atmosphère de folie criminelle, il la cannibalise aussi, il s’en nourrit assurément. Et de fait, vous avez cité leurs noms, les années 1970, avant et après Taxi Driver, sont fertiles en homicidal maniacs, en passages à l’acte violents, ce qui relève en même temps d’une terrible filiation historique aux États-Unis, comme une tradition qui ne cesse de se perpétuer et remonte, pour rester dans le cas de l’assassinat politique qui est l’un des scénarios en jeu dans le film, à John Wilkes Booth en 1865 tirant sur Abraham Lincoln dans sa loge du théâtre Ford avant de sauter sur la scène, de déclamer une tirade préméditée et à coup sûr répétée en prévision du rôle de sa vie, puis de s’enfuir en boitant par la coulisse.

En amont de sa réalisation, Taxi Driver se nourrit de cette folie homicide, en particulier du cas d’Arthur Bremer qui, en mai 1972, a tiré sur le gouverneur Wallace, un cas qui inspire directement Paul Schrader (le premier jet du film date de l’été de cette même année) et son intérêt relancé par la découverte et la publication du journal de Bremer. Et en aval, on connaît l’histoire de John Hinckley Jr., qui tire en 1981 sur le président Ronald Reagan pour attirer l’attention de la Jodie Foster du film de Scorsese, un film qu’il avait vu plus d’une quinzaine de fois et qui fut projeté à son procès… Mais là où John Hinckley n’a rien compris, rien voulu ou rien pu comprendre à Taxi Driver, c’est que le film, certes s’inspire lui aussi d’une réalité ou de réalités, par exemple le pitoyable passage à l’acte de Bremer qui, comme les autres, cherchait désespérément à exister, mais aussi et surtout qu’il s’échappe de cette réalité de base, il la dépasse et la recrache, il s’en sert comme d’un tremplin pour accéder par les moyens du cinéma à une autre définition du “criminel”, moins commune, et qui voisine dans l’économie non réaliste du film avec celle d’“artiste” – on y reviendra sans doute.
« Le film canalise une atmosphère de folie criminelle, il la cannibalise aussi, il s’en nourrit assurément. »
Le film constitue, cependant, une critique de l’obscénité des médias qui, à l’époque, mettent des criminels en une de leurs magazines, contribuant en cela à l’édification de leur célébrité (Lynette Fromme fait la couverture de Newsweek)…
Oui, c’est l’affaire Lynette Fromme, du nom de cette disciple complètement éberluée de Charles Manson et qui tire sur le président Gerald Ford en septembre 1975, le rate parce que son revolver s’est enrayé et prononce ces mots “historiques” : « C’est pas sorti ! »… C’est la disproportion entre la bêtise de son acte et de ses déclarations, d’une part, et son exposition médiatique d’autre part qui a choqué Schrader et lui a donné l’idée de l’épilogue de Taxi Driver, juste avant la fin du tournage, du moins sa part d’ironie puisque Travis, ce “nobody” jusque-là, devient une sorte de héros et fait les gros titres à la suite du bain de sang qu’il a déclenché. Ce n’est pas la seule dimension de cet épilogue, mais du point de vue du scénariste, c’est une fin en forme de critique des lois du spectacle ou du cirque médiatique, de l’irresponsabilité des supposés responsables de l’information. Un ton qu’on retrouvera au final de La Valse des pantins de Scorsese (1982), avec le même De Niro, ce qui est normal tant les deux films ont à voir l’un avec l’autre.
Vous rapprochez Taxi Driver des fictions de Dostoïevski, notamment Les Carnets du sous-sol et Le Double, dont les personnages principaux sont des antihéros, paranoïaques, à la limite de la folie. Par ailleurs, Paul Schrader affirme avoir lu L’Étranger de Camus et La Nausée de Sartre pour s’imprégner de l’état d’esprit du personnage de Travis. De par ces références, peut-on dire que Travis Bickle incarne la version moderne de « l’homme du ressentiment » ?
 Travis est assurément un personnage dostoïevskien, principalement parce que Schrader et Scorsese étaient l’un et l’autre obsédés par l’œuvre de l’écrivain russe, Les Carnets du sous-sol évidemment, Le Joueur aussi (dont Scorsese s’inspirera très librement pour son épisode de New York Stories, intitulé « Life Lessons« , 1989), mais encore et surtout selon moi Le Double avec ce personnage qui, dès son réveil, doute de la réalité environnante et se demande s’il ne s’agit pas plutôt de « la continuation des visions désordonnées de ses rêves ». Cette notion ou cette métaphysique du double électrise Taxi Driver, elle permet à la grande scène du miroir de prendre toute son ampleur, ainsi que d’autres moments qui précèdent et préfigurent cet avènement au miroir du “double” et sa prise de pouvoir ; je pense, entre autres scènes de dédoublement ou de décorporation de Travis, c’est-à-dire de dissociation de son corps et de son point de vue, à ce travelling latéral qui part du personnage accroché au téléphone, éploré, tandis que la caméra le laisse là jusqu’à le sortir du cadre et s’en va, seule, filmer la perspective d’un couloir vide : qui, ici, regarde ce que l’on voit ? C’est comme si un autre Travis se manifestait à cette occasion et demandait à s’exprimer. De ce plan et de ce mouvement de caméra, Scorsese a dit qu’il les tenait pour les plus importants de tout le film.
Travis est assurément un personnage dostoïevskien, principalement parce que Schrader et Scorsese étaient l’un et l’autre obsédés par l’œuvre de l’écrivain russe, Les Carnets du sous-sol évidemment, Le Joueur aussi (dont Scorsese s’inspirera très librement pour son épisode de New York Stories, intitulé « Life Lessons« , 1989), mais encore et surtout selon moi Le Double avec ce personnage qui, dès son réveil, doute de la réalité environnante et se demande s’il ne s’agit pas plutôt de « la continuation des visions désordonnées de ses rêves ». Cette notion ou cette métaphysique du double électrise Taxi Driver, elle permet à la grande scène du miroir de prendre toute son ampleur, ainsi que d’autres moments qui précèdent et préfigurent cet avènement au miroir du “double” et sa prise de pouvoir ; je pense, entre autres scènes de dédoublement ou de décorporation de Travis, c’est-à-dire de dissociation de son corps et de son point de vue, à ce travelling latéral qui part du personnage accroché au téléphone, éploré, tandis que la caméra le laisse là jusqu’à le sortir du cadre et s’en va, seule, filmer la perspective d’un couloir vide : qui, ici, regarde ce que l’on voit ? C’est comme si un autre Travis se manifestait à cette occasion et demandait à s’exprimer. De ce plan et de ce mouvement de caméra, Scorsese a dit qu’il les tenait pour les plus importants de tout le film.
Alors, Travis incarne assurément ou actualise « l’homme du ressentiment », mais – c’est en cela que le personnage ne peut ni ne doit être réduit à sa seule paranoïa – il est aussi l’homme du pressentiment, celui de la puissance de son esprit, encore une fois si l’on considère tout le film, massacre final compris, comme “une vue de l’esprit”, la figuration d’une expression artistique, celle de ses trois créateurs qui trouvent en Travis un lieu de convergence de leurs aspirations. En se souvenant du tournage du grand massacre et de tout le faux sang versé des murs au plafond, Michael Chapman s’est exclamé : « On aurait dit un Rauschenberg ! » Quant à Schrader, il a dit une fois à De Niro, ce même De Niro qui avant de tourner Taxi Driver avait lui-même écrit un début de scénario étonnamment proche, soit l’histoire d’un gamin qui se baladait au hasard des rues de New York, une arme à la main : « Tu sais ce qu’il représente, le flingue, hein Bobby ? Il représente tout ton talent. À cet instant précis de ta vie, tu savais que tu trimbalais cet énorme talent avec toi, et tu ne savais pas quoi faire avec. Tu étais embarrassé. Tu savais que si tu avais un jour l’occasion de dégainer et de tirer, les gens réaliseraient alors combien tu es important, et tu obtiendrais leur reconnaissance. » Et Schrader d’ajouter à l’intention de son intervieweur : « C’est la même chose qui m’a poussé à écrire Taxi Driver, et la même chose qui a amené Marty à le tourner. » Loin d’un homme unidimensionnel, Travis est bien un homme paradoxal, pour reprendre un mot de Dostoïevski.
La description du “criminel” selon Nietzsche semble également parfaitement correspondre aux passions aigres qui animent Travis. Une scène accrédite par ailleurs l’analogie du criminel et de l’artiste (acteur, cinéaste ou poète) : celle du cinéma porno où Travis, de ses doigts, fait un geste de tueur (viser l’écran), puis un geste de cinéaste (cadrer l’espace). Mû par une inspiration commune, Schrader, Scorsese et De Niro se seraient-ils eux-mêmes projetés dans ce nouvel archétype du criminel ?
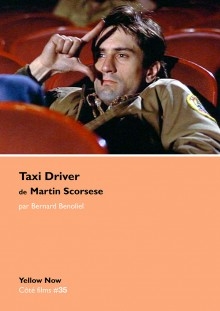 La découverte du texte de Nietzsche, cette « Divagation n° 45 » dans Crépuscule des idoles, a été l’un des sésames de l’écriture de ce livre. D’abord parce que, dans ce livre sur un renversement possible du sens d’un film, Nietzsche me paraissait tout indiqué, lui qui s’est affirmé avec raison comme le penseur de « l’inversion de toutes les valeurs » (morales). Ensuite parce qu’il cite Dostoïevski dans cette « Divagation », cet écrivain qui fut un bagnard, et, d’un coup, une cohérence et un jeu d’échos s’établissait. Enfin parce que son argument qui consiste à décrire le type du “criminel” comme « un homme fort que l’on a rendu malade », puis à ajouter : « presque toutes les formes d’existence que nous distinguons et honorons maintenant ont autrefois vécu dans cette atmosphère à demi sépulcrale[l’atmosphère du monde souterrain, le monde de Travis avant le miroir] : l’esprit tourné vers les sciences, l’artiste, le génie, l’esprit fort, l’acteur, le marchand, le grand explorateur… », fait alors entrevoir clairement la parenté, la proximité entre le criminel et l’artiste, et établit entre l’un et l’autre une différence de degré et non de nature. Nietzsche a titré son texte : « Le criminel et ceux qui lui ressemblent ». Un texte qui décrit donc Travis et, à travers lui, les trois autres au moment de Taxi Driver, Schrader, Scorsese et De Niro. Scorsese l’a exprimé une fois, à sa façon : « Il y a un Travis en chacun de nous », lui qui se vivait jusque-là comme un exclu du monde cinématographique, un outsider, un hors caste, un impur aux « pensées et actions marquées aux couleurs du monde souterrain » (Nietzsche). Le criminel et l’artiste nietzschéen sont de la même espèce. Alors oui, dans le registre défini par le film, Travis est la figure inhabituelle, méconnaissable, d’un créateur, d’où son double geste devant l’écran du cinéma porno, un double geste qu’avec l’éditeur j’ai choisi de placer pour l’un en couverture du livre (le geste de cadrer l’espace de la main, un geste de cinéaste) et pour l’autre en quatrième de couverture (le geste de viser l’écran, un geste de tueur). En anglais, to shoot signifie “tirer” et “tourner”.
La découverte du texte de Nietzsche, cette « Divagation n° 45 » dans Crépuscule des idoles, a été l’un des sésames de l’écriture de ce livre. D’abord parce que, dans ce livre sur un renversement possible du sens d’un film, Nietzsche me paraissait tout indiqué, lui qui s’est affirmé avec raison comme le penseur de « l’inversion de toutes les valeurs » (morales). Ensuite parce qu’il cite Dostoïevski dans cette « Divagation », cet écrivain qui fut un bagnard, et, d’un coup, une cohérence et un jeu d’échos s’établissait. Enfin parce que son argument qui consiste à décrire le type du “criminel” comme « un homme fort que l’on a rendu malade », puis à ajouter : « presque toutes les formes d’existence que nous distinguons et honorons maintenant ont autrefois vécu dans cette atmosphère à demi sépulcrale[l’atmosphère du monde souterrain, le monde de Travis avant le miroir] : l’esprit tourné vers les sciences, l’artiste, le génie, l’esprit fort, l’acteur, le marchand, le grand explorateur… », fait alors entrevoir clairement la parenté, la proximité entre le criminel et l’artiste, et établit entre l’un et l’autre une différence de degré et non de nature. Nietzsche a titré son texte : « Le criminel et ceux qui lui ressemblent ». Un texte qui décrit donc Travis et, à travers lui, les trois autres au moment de Taxi Driver, Schrader, Scorsese et De Niro. Scorsese l’a exprimé une fois, à sa façon : « Il y a un Travis en chacun de nous », lui qui se vivait jusque-là comme un exclu du monde cinématographique, un outsider, un hors caste, un impur aux « pensées et actions marquées aux couleurs du monde souterrain » (Nietzsche). Le criminel et l’artiste nietzschéen sont de la même espèce. Alors oui, dans le registre défini par le film, Travis est la figure inhabituelle, méconnaissable, d’un créateur, d’où son double geste devant l’écran du cinéma porno, un double geste qu’avec l’éditeur j’ai choisi de placer pour l’un en couverture du livre (le geste de cadrer l’espace de la main, un geste de cinéaste) et pour l’autre en quatrième de couverture (le geste de viser l’écran, un geste de tueur). En anglais, to shoot signifie “tirer” et “tourner”.
« Tu veux être une star ? Alors, tu en baves pendant quarante ans, ou tu descends dans la rue abattre quelqu’un de célèbre ! » Jerry Lewis
De Taxi Driver à La Valse des pantins, Martin Scorsese filme la solitude et la détresse de héros en mal de reconnaissance (« Dans n’importe quelle rue de n’importe quelle ville, il y a un inconnu qui rêve de devenir quelqu’un »). Le désir de réussite par tous les moyens, fussent-ils criminels, n’est-il pas un des motifs récurrents de son œuvre ?
Je l’ai dit, Taxi Driver et La Valse des pantins sont des films cousins. D’un film à l’autre, certaines parentés sont évidentes, jusqu’à une même structure de montage de deux séquences que je compare dans le livre. Mais pour répondre à votre question, le désir de réussite et de reconnaissance sociale est plus fort, plus prioritaire, plus au travail dans La Valse des pantins que dans Taxi Driver. Ce personnage joué une nouvelle fois par Robert De Niro, ce “fou du roi”, archétype de l’admirateur et du stalker, prêt à tout pour prendre la place de l’animateur vedette interprété par Jerry Lewis, c’est lui d’une certaine manière, plus que Travis, qui a récupéré la soif de reconnaissance, le désir à n’importe quel prix de visibilité d’un Arthur Bremer par exemple. Au moment de la sortie de La Valse des pantins, il y avait cette tagline, ce slogan, dans le dossier de presse du film : « Le rêve américain n’est plus aujourd’hui d’être riche, c’est d’être vu. » Et à propos du personnage de De Niro dans La Valse des pantins et de ce que vous appelez ce désir de réussite criminelle, je pense à deux déclarations. L’une de Jerry Lewis à Scorsese, sur le tournage, et qui résonne avec les Lynette Fromme, les Arthur Bremer et tant d’autres : « Tu veux être une star ? Alors, tu en baves pendant quarante ans, ou tu descends dans la rue abattre quelqu’un de célèbre ! ».L’autre est de Paul Zimmerman, le scénariste de La Valse des pantins : « En 1970, j’avais vu une émission sur les chasseurs d’autographe ; j’avais été frappé de voir combien ceux-ci ressemblaient à des assassins. »

Mais encore une fois, tout cela n’est qu’un des niveaux de Taxi Driver, et dans tout le livre je n’oublie jamais ce qui est selon moi son but ou sa représentation ultime : le film n’est pas seulement le portrait-robot du criminel de tabloïd, il est surtout, aussi étonnant que cela puisse paraître à première vue, la représentation d’un Moi créateur.
L’influence du cinéma européen est manifeste. Scorsese confesse avoir été imprégné par les films Pickpocket (Robert Bresson) et Salvatore Giuliano (Francesco Rosi) mais aussi Godard et Fassbinder. Paul Schrader, de son côté, admirait Bergman et considérait Travis comme une sorte de Nosferatu new-yorkais. Pourtant, les deux influences majeures de Taxi Driver semblent surtout être Psychose(Hitchcock) et La Prisonnière du désert (Ford).
Au jeu du nombre d’influences, Taxi Driver, véritable précipité de la cinéphilie vorace de Scorsese, détient peut-être une sorte de record et il serait trop long d’énumérer les films qui le traversent. Pour s’en tenir aux noms que vous citez, ainsi John Ford, la référence à La Prisonnière du désert est avérée et même explicite, y compris pour Schrader qui en fera un remake dès son deuxième film en tant que réalisateur (Hardcore, 1979). Scorsese, quant à lui, avait déjà ouvertement cité le film de Ford dans son premier long métrage, Who’s That Knocking at My Door (1967). Et dans Taxi Driver, le scénario de La Prisonnière du désert revient sous la forme de la mission que Travis s’assigne de sauver Iris (Jodie Foster), de l’arracher aux mains de son souteneur, l’homme aux cheveux longs, “l’indien”, joué par Harvey Keitel, comme John Wayne reprenait au Comanche surnommé Scar la jeune Debbie (Natalie Wood) qui avait été enlevée. Cette référence, c’est l’un des scénarios de Travis, l’un des scénarios qui voyagent dans Taxi Driver, ce film monstre.
 Quant à Hitchcock, Psychose (1960) sans doute, mais aussi Frenzy (1972) pour l’immense travelling arrière qui descend l’escalier vide après le massacre, sort de l’immeuble et va jusque dans la rue. Mais aussi Le Faux Coupable (1956) : déjà un film new-yorkais, déjà une intrigue comme vue par son propre personnage, déjà une musique entêtante de Bernard Herrmann qui s’essaie à des sonorités jazz… Du Faux Coupable, Scorsese a explicitement cité comme source d’inspiration les mouvements de caméra lors de la scène à la compagnie d’assurances et le jeu des points de vue des employées derrière le comptoir observant Henry Fonda à la dérobée : « C’était le genre de paranoïa que je voulais retrouver [dans Taxi Driver].« Il faut aussi rappeler le personnage de Betsy, joué par Cybill Shepherd, évidemment une réminiscence de la blonde hitchcockienne moitié Grace Kelly (Fenêtre sur cour) et moitié Kim Novak (Vertigo). On pourrait même dire que le scénario de Taxi Driver est tellement hitchcockien que le premier cinéaste auquel Schrader l’a fait lire, c’est Brian De Palma…, qui à son tour l’a passé à Scorsese.
Quant à Hitchcock, Psychose (1960) sans doute, mais aussi Frenzy (1972) pour l’immense travelling arrière qui descend l’escalier vide après le massacre, sort de l’immeuble et va jusque dans la rue. Mais aussi Le Faux Coupable (1956) : déjà un film new-yorkais, déjà une intrigue comme vue par son propre personnage, déjà une musique entêtante de Bernard Herrmann qui s’essaie à des sonorités jazz… Du Faux Coupable, Scorsese a explicitement cité comme source d’inspiration les mouvements de caméra lors de la scène à la compagnie d’assurances et le jeu des points de vue des employées derrière le comptoir observant Henry Fonda à la dérobée : « C’était le genre de paranoïa que je voulais retrouver [dans Taxi Driver].« Il faut aussi rappeler le personnage de Betsy, joué par Cybill Shepherd, évidemment une réminiscence de la blonde hitchcockienne moitié Grace Kelly (Fenêtre sur cour) et moitié Kim Novak (Vertigo). On pourrait même dire que le scénario de Taxi Driver est tellement hitchcockien que le premier cinéaste auquel Schrader l’a fait lire, c’est Brian De Palma…, qui à son tour l’a passé à Scorsese.
Vous observez un changement radical lors de la célèbre séquence du miroir : au plan 556, toute la séquence est filmée dans le miroir. Et tout bascule : « La caméra, le personnage, l’acteur, le cinéaste, le spectateur, le film, tout le monde est passé “derrière le miroir”. » En quoi ce basculement soudain constitue-t-il la pierre de touche du film ?
Oui, tout bascule, et tout bascule enfin tant le film a travaillé, souterrainement jusque-là, à cette bascule spectaculaire qui se produit après une heure de film. Que se produit-il d’inédit dans la deuxième scène du miroir (elle est double dans le film ou en deux temps, mais l’œil et l’esprit du spectateur confondent généralement les deux scènes pour n’en faire qu’une après coup) ? Une deuxième scène qui n’était pas écrite par Schrader, indiquée d’une ligne dans le scénario et improvisée sur le tournage, le même Schrader qui avait en revanche écrit dans l’introduction de son récit : « On ne peut pas toujours empêcher le diable de sortir de sa boîte. » Qu’est-ce qui se produit dans cette scène et qui n’a pas été bien vu me semble-t-il ? Il se produit le moment de l’avènement irréversible de Travis 2, bien que ce “double” ne soit pas un autre mais le même, Travis 2 tapi dans Travis 1, Travis 2 dont la présence s’était déjà manifestée de plusieurs façons dont une que je vous ai décrite : le travelling latéral qui va du téléphone au couloir, la dissociation corps/vision. Mais ici, Travis 2 surgit à la façon dont Schrader a parlé de l’écriture du scénario de Taxi Driver : « Il a surgi de moi comme un animal. » La mise en scène de Scorsese fait bondir Travis 2, elle l’impose en le filmant dans le miroir et plein cadre, en ne revenant pas à Travis 1 de toute la séquence et jusqu’à l’épilogue du film, même si ce premier Travis à son tour continuera de se manifester sporadiquement.
« Il y a un Travis en chacun de nous. » Martin Scorsese
La scène dite du miroir ou au miroir est en fait une scène dans le miroir, et en un raccord à 180° (le 556ème plan du film) que je décris dans le livre, le reflet de Travis est devenu le référent qui peut alors s’adresser à son ancien Moi : « You talkin’ to me ? » La mise en scène désigne le reflet comme le vrai Moi, et le vrai Moi est un animal qui se débat pour exister. Longtemps tapi dans la jungle de New York, il a attendu son heure, et c’est l’heure de sa libération. Autrement dit, à partir du plan 556, ce n’est plus Travis qui s’adresse à son image dans le miroir mais son image à Travis, pour le congédier sur le champ : « I’m the only one here. » C’est la vie à l’envers, à moins qu’elle ne s’en retrouve à l’endroit.

La relecture de cette séquence, célébrissime et cruciale, a été déterminante dans ma compréhension du personnage et du film. Ce sens renouvelé a concerné tous les moments de l’analyse, je n’ai cessé d’y revenir comme pour mieux en libérer toutes les puissances. Dans un jeu de va-et-vient, cette séquence m’a aidé à comprendre deux films qui, en retour, m’ont permis de mieux la comprendre, deux films auxquels je me suis adossé pour aller plus loin : l’un est un épisode de la série TV de La Quatrième Dimension, « Nervous Man in a Four Dollar Room » (« L’Homme et son Double », 1960), tellement proche de la séquence du miroir de Taxi Driver que c’est à se demander s’il ne serait pas revenu d’une manière ou d’une autre pour informer la mise en scène de Scorsese et le jeu d’acteur de De Niro. L’autre, toujours en rapport avec le jeu de De Niro – un jeu auquel je consacre tout le dernier chapitre –, est un film de De Palma, Hi Mom ! (1970), où dans une séquence le jeune De Niro se livre à une improvisation qui met sur la voie de celle au miroir dans Taxi Driver, en même temps qu’elle permet d’approfondir ce qu’on entend généralement par “improvisation”, l’acception générale étant une simplification d’un travail qui vient de bien plus loin que la seule inspiration au moment de la scène, aussi spectaculaire soit-elle.
Sylvain Métafiot
Nos Desserts :
- Vous pouvez vous procurer les ouvrages de Bernard Benoliel chez votre libraire
- Une leçon de cinéma par Martin Scorsese animée par Serge Toubiana et Costa-Gavras
- Retrouvez l’analyse de Bernard Benoliel lors de sa conférence « Taxi Driver, un montage, dé-montages »
- Quand Bernard Benoliel parle de « la caméra endoscopique de Martin Scorsese »
- Jean-Baptiste Thoret a également donné une conférence sur Marty, intitulée « Martin Scorsese, vitesse trompeuse »
- Regardez en ligne deux vidéos de l’émission Blow Up : le Top 5 musical de Martin Scorsese et le Top 5 des taxis au cinéma
10:25 Publié dans Cinéma | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, bernard benoliel, taxi driver, robert de niro, folie criminelle des seventies, martin scorsese, paul schrader | Lien permanent | Commentaires (0)










Écrire un commentaire