jeudi, 11 avril 2019
Olivier Maillart : « Nous sommes toujours des spectateurs à l’intérieur et en dehors des salles de cinéma »

Article initialement publié sur Le Comptoir
Co-directeur du « Dictionnaire du cinéma italien« (Nouveau Monde Éditions, 2014), Olivier Maillart est aussi l’auteur d’une étude sur « Lola Montès« de Max Ophuls (Éditions Atlande, 2011), et contribue régulièrement aux revues L’Atelier du Roman, Philitt et L’Inconvénient. Il vient de publier « Énigmes, cinéma » aux éditions Marest, un intriguant petit essai qui interroge notre désir de déceler derrière chaque image un sens caché, derrière chaque symbole un mystère à résoudre, comme à la recherche d’un trésor perdu que seuls des yeux exercés à la scrutation minutieuse des photogrammes pourraient découvrir. Une quête éperdue de l’interprétation filmique, faisant naître un « dialogue esthétique entre le monde, l’œuvre d’art et celui qui vit dans le premier et contemple la seconde », et dans laquelle nous ne cessons de nous perdre.
Le Comptoir : En quoi le cinéma serait-il une énigme ? À première vue, il n’y a rien de plus plat et de plus explicite qu’une image projetée sur un écran. Y aurait-il forcément un sens caché qui échappe au spectateur, un secret derrière la porte pour reprendre le titre d’un film de Fritz Lang ?
 Olivier Maillart : Il n’est pas sûr que le cinéma soit en lui-même une énigme. Cependant, sa manière de nous restituer le monde est bien souvent susceptible de faire de ce dernier quelque chose d’énigmatique, affichant signes et symboles à déchiffrer. Le cinéma capte, enregistre et restitue (partiellement, mais d’une manière étonnamment convaincante pour nos sens) le monde, sous la forme d’une image animée, projetée sur une surface plane, qui mime la réalité. Cependant, ce que vous prenez pour quelque chose de « plat » et d’ »explicite » ne l’est à vos yeux que parce que vous avez appris à la lire, dès votre plus jeune âge, de manière largement inconsciente. Songez au héros des Carabiniers de Godard qui, devant l’image d’une femme prenant son bain, essayait de pénétrer l’écran pour l’y rejoindre ! Le cinéma, comme tout art et tout langage, demande un apprentissage. Un apprentissage à la lecture d’image, qui rejoint notre habitude (largement inconsciente, elle aussi) de la lecture des signes que la vie en société nous envoie en permanence. Nous sommes toujours, pour partie, où que nous soyons, des spectateurs, à l’intérieur et en dehors des salles de cinéma. Mon livre s’efforce de réfléchir à cette situation qui ne cesse de m’étonner, et de m’émerveiller.
Olivier Maillart : Il n’est pas sûr que le cinéma soit en lui-même une énigme. Cependant, sa manière de nous restituer le monde est bien souvent susceptible de faire de ce dernier quelque chose d’énigmatique, affichant signes et symboles à déchiffrer. Le cinéma capte, enregistre et restitue (partiellement, mais d’une manière étonnamment convaincante pour nos sens) le monde, sous la forme d’une image animée, projetée sur une surface plane, qui mime la réalité. Cependant, ce que vous prenez pour quelque chose de « plat » et d’ »explicite » ne l’est à vos yeux que parce que vous avez appris à la lire, dès votre plus jeune âge, de manière largement inconsciente. Songez au héros des Carabiniers de Godard qui, devant l’image d’une femme prenant son bain, essayait de pénétrer l’écran pour l’y rejoindre ! Le cinéma, comme tout art et tout langage, demande un apprentissage. Un apprentissage à la lecture d’image, qui rejoint notre habitude (largement inconsciente, elle aussi) de la lecture des signes que la vie en société nous envoie en permanence. Nous sommes toujours, pour partie, où que nous soyons, des spectateurs, à l’intérieur et en dehors des salles de cinéma. Mon livre s’efforce de réfléchir à cette situation qui ne cesse de m’étonner, et de m’émerveiller.
« Le cinéma, comme tout art et tout langage, demande un apprentissage. »
Pourquoi faire de Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock le « le film par excellence de l’homme qui regarde, du monde comme énigme », davantage que d’autres films où excelle la pulsion scopique, tels Psycho du même Hitchcock, Le Voyeur de Michael Powell ou Le Locataire de Roman Polanski ?
La différence entre Fenêtre sur cour et les autres films que vous mentionnez me semble assez facile à cerner : le personnage incarné par James Stewart, rivé à son fauteuil (il a la jambe dans le plâtre) à la suite d’un accident, est réduit à son seul regard. Il n’est plus qu’un regard, pourrait-on dire en forçant un peu le trait, ce qui n’est pas le cas des autres personnages que vous évoquez. Stewart doit déléguer en permanence, demander de l’aide pour la moindre action. C’est sa fiancée, jouée par Grace Kelly, qui pénétrera dans l’appartement du meurtrier à sa place. Et lorsqu’il sera menacé, c’est avec le flash de son appareil photo qu’il se défendra, après avoir passé toute la durée du film à s’identifier à ses jumelles. Il est, décidément, le meilleur « homme-regard » qu’on puisse imaginer.
15:26 Publié dans Cinéma | Tags : Énigmes cinéma, le comptoir, sylvain métafiot, olivier maillart, nous sommes toujours des spectateurs à l’intérieur et en dehors | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 22 février 2019
Louis Blanchot : « Tom Cruise se pense condamné à demeurer éternellement une icône magnétique »
Article initialement publié sur Le Comptoir
Critique de cinéma pour les revues « Carbone », « SoFilm » et « Chronic’art », Louis Blanchot est l’auteur d’un essai sur l’acteur le plus survitaminé d’Hollywood : « Les Vies de Tom Cruise » (éditions Capricci). Un ouvrage qui explore les multiples métamorphoses d’un comédien qui – non content d’incarner depuis plus de vingt ans, et avec la même fougue, l’agent Ethan Hunt dans « Mission Impossible » – peut se targuer d’une filmographie à l’éclectisme impressionnant. Ayant collaboré avec des réalisateurs aussi prestigieux que Martin Scorsese, Oliver Stone, Stanley Kubrick, Paul Thomas Anderson, Sidney Pollack ou Steven Spielberg, Cruise, porté par l’inertie d’un élan qui semble ne connaître aucune pause, continue à forger sa légende d’action-héro au point de se confondre avec sa propre image.
Le Comptoir : Le titre de votre essai sous-entend une certaine schizophrénie filmique chez Tom Cruise (« Une identité unique et déclinable, laquelle lui permet de passer d’un univers à un autre comme les toons de Tex Avery ou de la Warner Bros. »). D’où provient cette malléabilité extrême ?
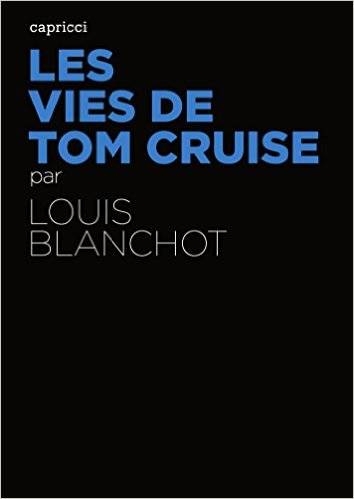 Louis Blanchot : Paradoxalement d’une certaine constance dans l’incarnation. À quelques exceptions plus ou moins heureuses près (ses rôles outranciers dans Tonnerre sous les tropiques ou Rock Forever), Tom Cruise s’en sera tenu à un registre de jeu certes maîtrisé mais plutôt étroit. S’il y a schizophrénie, c’est dans la façon dont la fiction va relancer et progressivement obscurcir cette image d’action man à tout faire. À force de jouer toujours le même rôle (lui contre le reste du monde), Cruise en a totalement épuisé le sens. C’est particulièrement prégnant dans Barry Seal : il campe un personnage menant une double voire une triple vie (une vie de famille, une autre d’espion, une dernière de brigand), mais chacune de ces existences pourtant contradictoires est interprétée par Cruise avec le même mélange de détermination et d’efficacité qu’au début de sa carrière. Il y a chez lui quelque chose qui ne change pas, qui ne veut pas changer, et cette invariabilité de tempérament le rend paradoxalement de plus en plus louche.
Louis Blanchot : Paradoxalement d’une certaine constance dans l’incarnation. À quelques exceptions plus ou moins heureuses près (ses rôles outranciers dans Tonnerre sous les tropiques ou Rock Forever), Tom Cruise s’en sera tenu à un registre de jeu certes maîtrisé mais plutôt étroit. S’il y a schizophrénie, c’est dans la façon dont la fiction va relancer et progressivement obscurcir cette image d’action man à tout faire. À force de jouer toujours le même rôle (lui contre le reste du monde), Cruise en a totalement épuisé le sens. C’est particulièrement prégnant dans Barry Seal : il campe un personnage menant une double voire une triple vie (une vie de famille, une autre d’espion, une dernière de brigand), mais chacune de ces existences pourtant contradictoires est interprétée par Cruise avec le même mélange de détermination et d’efficacité qu’au début de sa carrière. Il y a chez lui quelque chose qui ne change pas, qui ne veut pas changer, et cette invariabilité de tempérament le rend paradoxalement de plus en plus louche.
« À force de jouer toujours le même rôle (lui contre le reste du monde), Cruise en a totalement épuisé le sens. »
S’il est une loi fondamentale qui innerve l’acteur c’est celle de la course-poursuite. Le « Everybody runs » de Minorty Report résonnant comme « le mantra cruisien, physique et métaphysique […] celui d’un homme traqué de toute part, et en même temps lancé à la recherche de lui-même. » Mais après quoi court-il sans cesse depuis bientôt quarante ans ?
Cruise court constamment parce qu’il n’a peut-être qu’un seul et véritable ennemi : le temps, qui joue toujours contre lui. D’abord parce qu’il est un héros d’action et que celui-ci doit souvent accomplir sa mission ou son exploit dans un délai impératif et incompressible (le compte à rebours n’est pas pour rien un des grands leviers à suspense du genre). Si Cruise court dans tous ses films, c’est donc par nécessité de prendre de vitesse les événements, de rattraper ce temps qui défile inexorablement et met en péril l’accomplissement de son destin. Mais d’un autre côté, Cruise court pour fuir le temps, ou en tout cas les effets du temps : la vieillesse, la dégradation physique, l’oubli. En tant que star, Cruise est engagé dans une lutte de plus en plus menaçante avec son propre déclin, qu’il s’agit pour lui d’ajourner, de conjurer. Et pour ce faire, la course et la mobilité sont bien évidemment ses meilleurs atouts. Car tant que Cruise court, tant que Cruise s’active, on ne voit pas les effets de la vieillesse sur lui, alors que chaque gros plan fixe sur son visage nous fait comprendre que cette décrépitude le guette.
10:45 Publié dans Cinéma | Tags : edge of tomorow, jerry maguire, eyes wide shut, top gun, le comptoir, sylvain métafiot, louis blanchot, tom cruise, mission impossible | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 28 janvier 2019
L’île aux sorcières : Les garçons sauvages de Bertrand Mandico

Article initialement publié sur Le Comptoir
À ceux qui considèrent que le cinéma français se résume aux bluettes exaspérantes de Louis Garrel ou aux comédies braillardes et vulgaires de Christian Clavier et Jean-Paul Rouve, le premier long-métrage de Bertrand Mandico vient infliger un démenti aussi radical que magnifique. On n’était clairement plus habitué à une telle inventivité visuelle. Et pourtant, depuis quelques années, le cinéma de genre français reprend incontestablement du poil de la bête : Alléluia de Fabrice du Welz (2016), Grave de Julia Ducournau (2017), Laisser bronzer les cadavres d’Hélène Cattet et Bruno Forzani (2017), Ghostland de Pascale Laugier (2018), La Nuit a dévoré le monde de Dominique Rocher (2018), Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez (2018) ou encore Revenge de Coralie Fargeat (2018). Quelques exemples certes inégaux mais portés par une audace que l’on peine à déceler dans la plupart des réalisations traditionnelles.
C’est là que le vaisseau étincelant de Mandico dépasse de plusieurs coudées ses confrères hallucinés en direction du monde des rêves spongieux, sexuellement détraqués et sans retour possible. Soit le récit initiatique de cinq jeunes garçons (« unis pour le meilleur et surtout pour le pire ») qui, après avoir commis un meurtre sauvage, sont embarqué de force sur le navire d’un capitaine autoritaire et répressif afin de les remettre dans le droit chemin. Peine perdue : les cinq sauvageons se rebiffent et accostent sur une île à l’écart de toute civilisation. Tout en explorant les lieux, leurs corps commencent à se métamorphoser… Le film de Mandico relève de l’incantation maléfique, monstre d’argile assemblé de manière surréaliste sous l’empire de drogues de synthèses inconnues. Porté par un noir et blanc intemporel duquel jaillit d’intempestives séquences bariolées, le voyage suinte délicieusement le stupre et la mort. Résolument transgenre tant sur la forme que sur le fond le film ondule du masculin au féminin, de Burroughs à Borowczyk, du sensoriel au sensuel, des sexes tatoués aux arbres phalliques, de l’ultra-violence au plaisir lascif. C’est une valse des contraires qui se cherchent, s’apprivoisent et s’étreignent : une copulation fantasmatique entre les formes premières du cinéma et la sève subversive des désirs primitifs.
Les amoureux non rassasiés de cette croisière raffinée et luxurieuse pourront se plonger dans les eaux troubles d’Ultra Rêve triptyque fiévreux de courts-métrages réalisés par Caroline Poggi et Jonathan Vinel, Yann Gonzalez et… Bertrand Mandico.
Sylvain Métafiot
17:28 Publié dans Cinéma | Tags : bertrand mandico, l’île aux sorcières, les garçons sauvages, le comptoir, sylvain métafiot, stupre, mort, sexe, ultraviolence | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 14 janvier 2019
L’homme du souterrain : The House that Jack built de Lars von Trier

Article initialement publié sur Le Comptoir
Lars von Trier aurait-il réalisé son grand oeuvre, sa grande farce macabre ? Celle qui boucle le cercle noir entamé dès Element of crime en 1984, point de départ d’une trilogie (suivront Epidemic et Europa) sur une Europe transformée en purgatoire urbain jalonnée d’histoires labyrinthiques et poisseuses. Ce n’est sans doute pas un hasard si, dans ce premier film, on entend la comptine populaire anglaise qui donne son titre au dernier long-métrage du cinéaste danois : plus qu’un indice, un memento mori filmique qui rappelle, à plus de trente ans d’écart, son obsession, teintée d’ironie, pour les pulsions criminelles et auto-destructrices nichées au cœur des hommes.
Les « incidents » qui parsèment The House that Jack built constituent les chapitres d’un conte moderne à la noirceur exacerbée et à l’humour grinçant. Construit sous la forme d’un long flash-back, Jack, le tueur psychotique et méthodique, raconte ainsi à Verge cinq meurtres avec une minutie et un détachement qui, en sus de l’horreur des actes proprement perpétrés, confinent à une drôlerie inattendue. Ainsi, des talents d’acteur et de bonimenteur de Jack pour tromper ses victimes, ses TOC qui l’obligent à nettoyer plusieurs fois la même scène de crime, son cynisme lorsqu’il avoue ses crimes à un policier indifférent, la chance insolente qui lui permet d’échapper à la justice et lave littéralement ses forfaits. S’estimant le bâtisseur d’un monument glorieux et immortel, Jack ne cesse de justifier ses actes ignobles en s’estimant le continuateur esthétique du génocide nazi, des purges staliniennes et autres massacres de masse, faisant de la « pourriture noble » son emblème oxymorique. De fait, seuls les geignards professionnels auront le tort de confondre le personnage et le cinéaste. Lars von Trier s’amuse de son anti-héros et de sa propre oeuvre. Verge, le confesseur antique de Jack, ne cesse de se moquer de son narcissisme, de son maniérisme, de ses pseudo alibis culturels, de ses rêves de grandeur. À la figure du nihilisme le plus destructeur qu’incarne Jack, Verge lui répond en tant que son adversaire humaniste, celui qui, tout en l’entraînant aux gouffres infernaux, lui fait prendre conscience de ses péchés.
Si parmi la kyrielle de références (William Blake, Dante, Delacroix, Glenn Gould, Virgile, David Bowie, le surréalisme…) on pense inévitablement à l’ouvrage de Thomas de Quincey, De l’assassinat considéré comme un des beaux-arts (1827), c’est à son Mangeur d’opium (1822) que fait songer la dernière partie du film, enchaînement de fascinants tableaux pandémoniaques ne laissant aucun doute sur le sort funeste réservé à Jack, ce « pathétique architecte raté » passé de la chambre froide du crime au neuvième cercle de l’enfer : « J’avais chaque nuit l’impression de descendre, non au sens métaphorique, mais de descendre littéralement, dans des gouffres et des abîmes sans soleil, des profondeurs infinis desquelles mon éventuelle remontée semblait désespérée. »
Sylvain Métafiot
16:14 Publié dans Cinéma | Tags : l’homme du souterrain, the house that jack built, lars von trier, le comptoir, sylvain métafiot, enfer, dante, delacroix, thomas de quincey | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 05 janvier 2019
Cimes cinéphiliques 2018
Qui succède à Laissez bronzer les cadavres ! de Hélène Cattet et Bruno Forzani au titre de meilleur film de l'année ? La réponse dans notre habituel top 10, suivi de son flop 10 tout aussi subjectif.
Au sommet cette année
1) Les Garçons sauvages de Bertrand Mandico : éloge des sorcières, des désirs sauvages et de l'androgynie suave.

2) Phantom Thread de Paul Thomas Anderson : confrontation et réunion entre la perfection formelle et l’anarchie vitaliste.

3) The House that Jack Built de Lars von Trier : l’homme du souterrain en quête de d’absolu criminel.

4) En liberté ! de Pierre Salvadori : la vie, en mieux. Et en plus drôle.

5) Seule sur la plage la nuit de Hong Sang-soo : fragments d’un exil amoureux.

21:00 Publié dans Cinéma | Tags : cimes cinéphiliques 2018, sylvain métafiot, seule sur la plage la nuit, en liberté, the house that jack built, les garçons sauvages, le poirier sauvage, hérédité, mektoub, my love, l'insulte, mademoiselle de joncquières, top 10, flop 10 | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 12 décembre 2018
Jean-François Rauger : « Sergio Leone a engendré un genre dont il a inventé l’essentiel de l’esthétique »

Article initialement publié sur Le Comptoir
Ses films sont vus et revus avec le même enthousiasme depuis 60 ans, il a inspiré des dizaines de cinéastes à travers le monde, ses personnages sont devenus des icônes de la culture populaire, sa mise en scène est étudiée dans toutes les écoles du cinéma, ses gros plans mille fois reproduits, et la musique de son ami Morricone résonne dans le cœur de toute une génération de spectateurs. À travers seulement sept films, Sergio Leone, longtemps méprisé par ses pairs, ne s’est pas contenté de réanimer avec panache un genre essoufflé, celui du western. Il a démontré que le cinéma, cet art alchimique par excellence, pouvait combiner, sous l’égide d’une Amérique fantasmée, la violence lyrique la plus stylisée avec une sensibilité intimiste et morale extrêmement raffinée. À l’occasion de l’exposition et de la rétrospective que lui consacre la Cinémathèque française nous nous sommes entretenu avec son directeur de la programmation, Jean-François Rauger.
Le Comptoir : C’est aujourd’hui entendu, Sergio Leone est un grand parmi les grands. Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi. Au début des années 60′, « Western spaghetti », avant d’être un étendard revendiqué, était une insulte proférée par des critiques n’acceptant le renouveau tapageur et moderne d’un genre qu’ils considéraient comme exclusivement américain. Pourquoi une telle levée de boucliers ?
Jean-François Rauger : Il y a eu un soupçon pesant sur la légitimité du western italien comme un genre détaché de toute racine culturelle. Mais pourquoi le cinéma ne pourrait-il pas, justement, trouver d’autres racines culturelles que celles légués par une certaine Histoire et une certaine géographie ? Ce fut un réflexe fétichiste et mélancolique à la fois, le constat de la disparition d’un moment de l’histoire du cinéma si bien incarné par le western américain et ses transformations successives. Ce fut aussi le refus de voir que la forme « dégradée » que représentait le western italien pouvait faire partie d’une forme de modernité tout comme la prédominance de la sensation sur le sens, du jeu sur la psychologie, a pu apparaître comme une forme de pornographie.

12:07 Publié dans Cinéma | Tags : jean-françois rauger, sergio leone, sylvain métafiot, le comptoir, il était une fois en amérique, le bon la brute et le truand, western spaghetti | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 31 octobre 2018
Bernard Benoliel : « “Taxi Driver” se nourrit de la folie criminelle des seventies »

Article initialement publié sur Le Comptoir
Directeur de l’action culturelle et éducative à la Cinémathèque française, ancien critique aux « Cahiers du cinéma » et auteur d’ouvrages sur Clint Eastwood et Bruce Lee, Bernard Benoliel a consacré un essai au cinquième long-métrage de Martin Scorsese : « Taxi Driver » (Yellow Now, 2017). Film fournaise marqué au fer rouge du Nouvel Hollywood qui, au cœur d’une décennie agitée de bouillonnements contestataires au sein de laquelle les œuvres de Friedkin, Polanski ou Altman ont redéfini les codes du film noir, enfièvre les rues de New York d’un hyper-réalisme hallucinatoire, d’une ultra-violence cathartique et d’un dédoublement obsessionnel.
Le Comptoir : Dès l’introduction de votre essai, vous affirmez vouloir prendre à rebours les interprétations communes sur Taxi Driver, en visionnant le film « comme dans un miroir ». Quels sont les commentaires habituellement émis sur le film et pourquoi vouloir s’en départir ?
 Bernard Benoliel : Taxi Driver est un film, à la mesure du choc provoqué à sa sortie et à chaque nouvelle vision, qui a suscité nombre d’analyses, d’interprétations, toute une glose critique très légitime, à la mesure aussi d’un phénomène essentiel : le film demeure pour une part énigmatique, il échappe à qui veut le cerner. Que peut-il bien signifier véritablement et, en particulier, comment comprendre les raisonnements et les actes de Travis Bickle, le personnage du taxi driver joué par Robert De Niro ? De ce point de vue, le film agit comme certains autres, célèbres et célébrés pour cette même raison, ce que la culture populaire appelle des films “cultes”, par exemple Vertigod’Hitchcock ou Mulholland Drive de Lynch, des œuvres avec lesquelles il est impossible d’en finir : « analyse terminée, analyse interminable », écrivait Freud en donnant bien sûr à l’analyse un autre sens qu’ici. En écrivant sur le film de Scorsese et en avançant dans son “analyse”, j’ai éprouvé ce vertige, cette spirale du sens, un vertige euphorisant car il encourage à toujours pousser plus loin, chaque fois le film répondant présent.
Bernard Benoliel : Taxi Driver est un film, à la mesure du choc provoqué à sa sortie et à chaque nouvelle vision, qui a suscité nombre d’analyses, d’interprétations, toute une glose critique très légitime, à la mesure aussi d’un phénomène essentiel : le film demeure pour une part énigmatique, il échappe à qui veut le cerner. Que peut-il bien signifier véritablement et, en particulier, comment comprendre les raisonnements et les actes de Travis Bickle, le personnage du taxi driver joué par Robert De Niro ? De ce point de vue, le film agit comme certains autres, célèbres et célébrés pour cette même raison, ce que la culture populaire appelle des films “cultes”, par exemple Vertigod’Hitchcock ou Mulholland Drive de Lynch, des œuvres avec lesquelles il est impossible d’en finir : « analyse terminée, analyse interminable », écrivait Freud en donnant bien sûr à l’analyse un autre sens qu’ici. En écrivant sur le film de Scorsese et en avançant dans son “analyse”, j’ai éprouvé ce vertige, cette spirale du sens, un vertige euphorisant car il encourage à toujours pousser plus loin, chaque fois le film répondant présent.
Alors oui, dans le préambule du livre, j’ai voulu résumer très vite le sens des commentaires majoritaires sur Taxi Driver, des commentaires qui parfois s’excluent ou s’opposent, ce qui de fait n’est pas étonnant, mais des commentaires qui, à force, ont tendance à figer le film et singulièrement Travis Bickle, un personnage qui se retrouve enfermé dans le tableau des psychoses – un portrait clinique qui encore une fois a sa part de vérité (le film est très “accueillant”) – et un personnage alors devenu seulement le révélateur d’une société déboussolée et criminogène. J’ai voulu assurément “libérer” Travis, le rendre à sa complexité ou à sa dualité.
On a beaucoup écrit aussi de Taxi Driver, sorti en 1976, qu’il faisait, à même le corps et l’âme de Travis – qui arbore plus d’une fois une veste militaire, appartenant au scénariste Paul Schrader –, le portrait d’un vétéran et témoignait d’un trauma d’après-guerre. Et même si Scorsese a déclaré : « Mon film n’est pas un commentaire sur le Vietnam. » De fait, certaines études ont fait de Taxi Driver un exemple patent de la crise de la masculinité en Occident dans les années 1970 quand d’autres ont annexé le même film pour lui faire rejoindre le corpus des vigilante movies, soit l’expression du retour d’une hyper virilité toujours en Occident et toujours à la même période.
De même, le film et le personnage, indissociables, ont beaucoup été lus à l’aune du catholicisme de Scorsese et du protestantisme de Schrader quand le réalisateur et le scénariste, pour leur part, ont souvent qualifié Travis de kamikaze, de samouraï ou de rônin, et même si Scorsese a dit une fois, nous aidant à mon sens à nous mettre sur le chemin du vrai Travis : « Travis, c’est la toute-puissance de l’esprit, mais sur le mauvais chemin. »
« On ne comprend rien à Taxi Driver si on refuse de voir que le film est traversé, travaillé en permanence par un “irréalisme”, un sur-réalisme ou un hyper réalisme qui confine au “gothique”, comme l’exprimait Scorsese, ou au fantastique. »
C’est cette piste que j’ai suivie, celle qui m’a paru la plus féconde et capable de renouveler une approche un peu en boucle du film, aidant à retourner ou renverser le sens, comme notre image s’inverse dans un miroir et comme celle du vrai Travis surgit dans la scène cruciale du miroir de Taxi Driver (« You talkin’ to me ? »). Et c’est précisément ma vision de cette scène névralgique qui m’a donné l’idée de proposer un renversement du sens du film. Ce faisant, il y avait la volonté aussi de rappeler les possibles puissances de l’analyse cinématographique tant je crois à une “politique du film”, à savoir qu’un film est le document primordial et qu’il en sait plus long que son auteur, ou ses auteurs en l’occurrence puisque ici on parle d’une création tricéphale, résultat de la volonté convergente de Scorsese, Schrader et De Niro, tous les trois sur une même longueur d’onde.
10:25 Publié dans Cinéma | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, bernard benoliel, taxi driver, robert de niro, folie criminelle des seventies, martin scorsese, paul schrader | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 29 mai 2018
Fragments d’un exil amoureux : Seule sur la plage la nuit de Hong Sang-soo

Article initialement publié dans le 10e numéro de Raskar Kapac
« Il faut mourir avec élégance », répète Younghee en portant la bière à ses lèvres, main sur le front et regard triste, passablement éméchée par l’alcool et usée par une déception amoureuse. « Personne n’est qualifié pour l’amour ! » ajoute-t-elle, exaspérée, à ses amis réunis autour de la table, installant un moment de gêne rapidement dissipé par un baiser saphique et une cigarette partagée sous la pluie. La joie reprend ses droits, pour un temps au moins. Aucun doute, nous sommes bien chez Hong Sang-soo. Promenades nocturnes en pleine ville, conversations sur la dilution des désirs dans le temps et la contrariété des sentiments qui refont surface, variations infimes des destinées, rencontres incongrues et repas bien arrosés, le style du réalisateur coréen est aisément repérable pour le spectateur qui, de films en films, accompagne ses personnages débonnaires et mélancoliques au gré de leurs beuveries mi-pathétiques mi-truculentes. Son dernier long-métrage, Seule sur la plage la nuit, ne fait pas exception. Et l'on retrouve – quelques mois à peine après la sortie du Jour d'après et avant la sortie de La Caméra de Claire – cet art délicat de filmer l'ébranlement des passions amoureuses par une mise en scène épurée et un regard caressant qui, s'il privilégie les plans fixes, joue des mouvements formels pour distiller une bizarrerie burlesque au sein de cette fable tragi-romantique.
Si fait, d’un hochement de caméra, d'un léger balayage de droite à gauche, les personnages se perdent dans leurs songes ou disparaissent du champ (ce qui revient au même). D’un zoom, la détresse de l’une se fige, la honte d’un autre devient palpable et le Quintette en ut majeur de Schubert retentit, étreint les cœurs. D’un changement de perspective, la même scène ouvre une nouvelle gamme dans la répétition de gestes et de paroles anodines, inclinant les personnages vers une toute autre fatalité. Si Hong Sang-soo s'amusait délibérément, à la faveur des variations d'angle, avec le thème du dédoublement dans Un jour avec, un jour sans et dans Yourself and Yours, il laisse ici son héroïne se perdre sur les rives hivernales des rêves enfouis, faisant de l’épuisement existentiel, plus que de la gémellité sentimentale, l’étoffe sablonneuse sur laquelle elle imprime son vague à l’âme. Portrait d'une jeune fille solitaire hantée par ses fantasmes, le récit brode ainsi une brisure intime sur des souvenirs épars, un désenchantement doux et amer face à l'absurdité du monde. En somme, le motif sublimement incarné de la désillusion des certitudes.
Sylvain Métafiot
21:13 Publié dans Cinéma | Tags : hong sang-soo, sylvain métafiot, seule sur la plage la nuit, fragments d'un exil amoureux, raskar kapac | Lien permanent | Commentaires (1)
jeudi, 29 mars 2018
Une affaire de femmes : « Ouaga Girls » de Theresa Traore Dahlberg
Article initialement publié sur Le Comptoir
Sélectionné au festival Visions du Réel et au festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou, « Ouaga Girls », premier long-métrage de Theresa Traore Dahlberg, suit pas à pas la formation de jeunes Burkinabées dans leur apprentissage de la mécanique automobile. Un choix professionnel osé et ardu dans un pays où – malgré une vague révolutionnaire et démocratique ayant modifié le paysage politique ces dernières années – le patriarcat domine toujours les mentalités. Un documentaire d’un féminisme solaire qui montre que s’émanciper c’est avant tout plonger joyeusement les mains dans le cambouis.
Dans un pays où l’agriculture représente 80 % de son économie, la décision d’entamer une carrière dans le secteur professionnel de la mécanique auto n’est pas une sinécure. Faire ce choix en étant une femme redouble l’audace, remettant en cause de sévères préjugés sur leurs capacités à exercer une autre fonction que mère au foyer, coiffeuse ou esthéticienne.
Car la condition des femmes au Burkina Faso n’est pas des plus riantes : sous-représentées dans l’enseignement secondaire et supérieur, souffrant d’un analphabétisme élevé, subissant des mariages précoces et forcés. Par ailleurs, les mutilations génitales ont beau être interdites depuis 1996, elles restent encore largement pratiquées. Ajoutons enfin à ce sombre tableau les assauts répétés d’attaques terroristes depuis 2016 (huit militaires tués lors de la dernière en date, du 2 mars dernier) du fait de la proximité du pays avec l’instabilité sahélienne et un indice de développement humain terriblement bas (185e sur 188).
00:08 Publié dans Cinéma | Tags : burkina faso, sylvain métafiot, une affaire de femmes, ouaga girls, theresa traore dahlberg, le comptoir | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 31 janvier 2018
Amer béton : « Taste of Cement » de Ziad Kalhtoum
Article initialement publié sur Le Comptoir
Lauréat de nombreux prix au sein de festivals internationaux où il fut accueilli avec ferveur, le documentaire « Taste of Cement » raconte le quotidien de travailleurs syriens, immigrés au Liban pour fuir la guerre civile de leur pays, s’affairant sur le chantier d’un gigantesque immeuble de Beyrouth. S’attachant à une mise en scène sensitive, avec un soin tout particulier accordé au son, le réalisateur syrien Ziad Kalhtoum ne sacrifie pas sa sensibilité d’artiste sur l’autel du discours militant, proposant une expérience de cinéma envoûtante sur un sujet pour le moins dramatique.
Petit rappel historique. De 1975 à 1990, le Liban a été le théâtre d’une guerre civile interconfessionnelle opposant, dans un premier temps, le Front libanais, à dominante maronite, à l’Organisation de libération de la Palestine, bras armé de la coalition “palestino-progressiste” musulmane. Interviendra par la suite l’armée israélienne (entraînant notamment le massacre des camps de Sabra et Chatila par les milices phalangistes), la coalition internationale, les partis chiites (Amal et Hezbollah) ainsi que des tentatives de cessez-le-feu émis depuis la Syrie. Près de 200 000 civils furent tués et des centaines de milliers d’autres exilés.
Vingt-un ans plus tard, la Syrie est elle-même en proie à une guerre civile à la suite de manifestations pacifiques réclamant, dans l’effervescence du Printemps arabe, la fin du régime autoritaire du président Bachar el-Assad. Réprimée dans le sang, la contestation du régime baasiste mute en conflit armé, entraînant dans son sillage une multitude d’acteurs (l’Armée syrienne libre, les brigades islamistes sunnites, le Front al-Nosra, l’État islamique, divers partis Kurdes syriens, les pays du Golfe, le Hezbollah, la Russie, l’Iran, les États-Unis…) et établissant une situation géopolitique d’une complexité inouïe. À ce jour, le nombre de victimes s’élève à plus de 500 000 et six millions de Syriens ont fui leur pays.
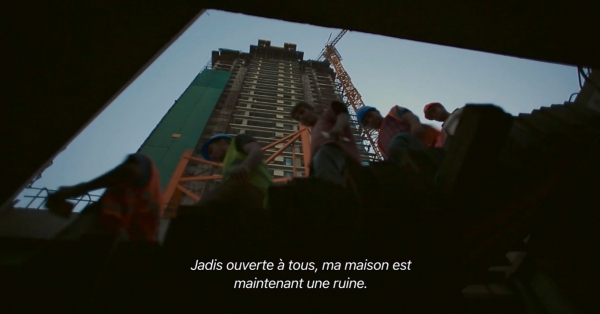
10:29 Publié dans Cinéma | Tags : sylvain métafiot, le comptoir, syrie, liban, ziad kalhtoum, guerre civile, amer béton, documentaire, taste of cement, destruction, construction, ciment | Lien permanent | Commentaires (0)









