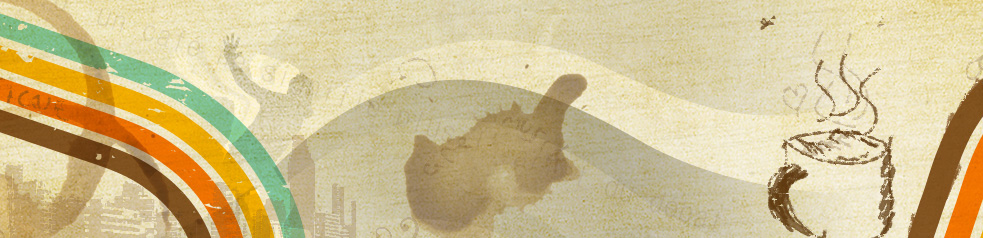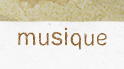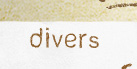mercredi, 26 mai 2021
En terre inconnue : Revue Zone Critique #2 "Aventure"

Après un premier numéro consacré à la crise sociale et plus de 18 mois de labeur, la revue Zone Critique sort son deuxième numéro avec comme thème central l’aventure. Premier constat, le bestiau est volumineux : 420 pages, soit quasiment le double du premier numéro ! Pages plus fines, couverture solide et maquette élégante, l’écrin est toujours aussi soigné. À défaut de le lire vous pourrez toujours l’envoyer à travers la gueule d’un lecteur du Nouveau Magazine littéraire. Mais ce serait gâcher.
Quid de cette aventure alors ? Elle est d’abord littéraire (le cœur de la revue) avec pas moins d’une quarantaine de contributions. On part ainsi sur les traces des aventuriers de l’errance que sont John Fante, Charles Bukowski et Mark SaFranko, on tente de renouer avec les explorations de l’Ancien monde en compagnie de Sylvain Tesson, on retrace l’expérience initiatique de Corto Maltese à travers les mers du globe, on accompagne le voyage de Dante Alighieri entre ciel et enfer, on suit les chevauchées motorisées de Neal Cassady et Jack Kerouac sur les routes américaines, on décolle avec l’Aéropostale et Saint-Exupéry aux commandes… Sans compter nombre de recensions d’ouvrages récemment parus tels L’Or du temps de François Sureau et son voyage le long des bords de Seine, La Cuillère de Dany Héricourt et son incursion dans l’infra-ordinaire, ou le premier roman de Nastassja Martin, Croire aux fauves, à la découverte d’une communauté évène des forêts du Kamtchatka.
Mais, loin de se limiter aux explorations autour du monde, l’aventure est également intérieure comme le rappelle Pierre Poligone en croisant les œuvres de Béatrice Douvre, Emmanuel Carrère et Vincent La Soudière. Pierre Chardot analyse, pour sa part, la recherche d’absolu chez Fernando Pessoa et son intériorité torturée. Cette quête d’absolu se retrouve également chez André Malraux dont Romain Debluë fait émerger « cette mystérieuse dialectique des aventures humaines avec l’unique aventure que constitue l’histoire tout entière de l’humanité ». L’écrivain Ernst Jünger, de son côté, choisira plutôt la « quête aventureuse d’entomologiste » pour accéder à la sagesse et au détachement intérieur. La revue propose également quatre entretiens bien touffus avec : le créateur de Bob Morane, Henri Vernes, ainsi que son plus célèbre illustrateur, Gérald Forton ; le professeur et biographe Jean-Yves Tadié à propos de son essai Le roman d’aventures ; l’universitaire Claude Leroy quant à son travail sur l’édition des œuvres complètes de Blaise Cendrars dans la Pléiade ; l’écrivain Emmanuel Ruben, récipiendaire du prix Nicolas Bouvier au festival Etonnant Voyageurs pour son roman Sur la route du Danube.
L’aventure est enfin cinématographique avec un entretien et un portrait d’Alain Guiraudie, le réalisateur de L’inconnu du lac dévoilant ses petites odyssées campagnardes, une visite du New-York fiévreux par les frères terribles Josh et Benny Safdie, une plongée dans les méandres de la folie des explorateurs acharnés avec Werner Herzog ou une balade sauvage à travers les grands espaces américains avec Kelly Reichardt. Le grand écran est peut-être le lieu de projection par excellence de tous les fantasmes aventureux en déployant un imaginaire visuel incroyablement immersif, à l’image des épopées spatiales, « véritable dernière frontière » comme le rappelle Olivier Maillart. Une recherche de l’inconnu et un dépassement des limites qui acquiert une dimension mystique, ainsi que l’analyse Célia Sanchez à travers Dersou Ouzala d’Akira Kurosawa et L’Ornithologue de João Pedro Rodrigues. Restera enfin à explorer les mondes infinis et connectés du vaste univers numérique, guidé en réalité virtuelle par Manon Boyer, pour clore le voyage.
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
10:47 Publié dans Cinéma, Littérature | Tags : kurosawa, guiraudie, safdie, werner herzog, carrère, pessoa, vincent la soudière, cendrars, neal cassady, jack kerouac, john fante, charles bukowski, mark safranko, le comptoir, zone critique, aventure, sylvain métafiot | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 10 mai 2021
L’art et la manière : L’Empire du non-sens de Jacques Ellul

Publié une première fois en 1980, L’Empire du non-sens de Jacques Ellul reparaît dans la collection Versus, dirigée par Patrick Marcolini, et agrémenté d’une préface inédite de notre camarade Mikaël Faujour. À travers une critique sociale, culturelle et anthropologique il énonce une thèse simple : l’art du XXe siècle — qu’il s’en défende ou qu’il le revendique, qu’il en soit conscient ou ignorant — est tout entier soumis au règne de la Technique, évacuant toute notion de beau, d’histoire, de sujet, d’agrément, de vie et donc de sens. Et « éliminer le sens de l’art, c’est en réalité éliminer le « pourquoi jusqu’ici l’homme a vécu ». C’est effectivement éliminer l’homme. »
Pour Ellul, le monde technicien tel que nous le vivons aujourd’hui est sans commune mesure avec les siècles précédents, englobant quasiment tous les domaines de la vie en société. De fait, l’artiste et les conditions de la « création artistique » n’échappent pas à ce nouvel état des choses. Quel sens peut donc bien avoir l’art moderne dans cette situation ? Ellul précise qu’il ne cherche pas à « montrer ce qui détermine l’art moderne, mais [à] expliquer pourquoi il est ce qu’il est ». Entre autres bouleversements, la Technique moderne a réduit l’invention esthétique à un simple « jeu parfaitement gratuit, allusif et individualiste » sans se référer à un système symbolique commun, une expérience commune : « L’œuvre de l’Art moderne est de procéder à la rupture radicale entre ces informations indépendantes spécifiques du signe, et le message, qui à la limite doit être exclu. » On supprime donc tout message et toute signification à l’œuvre (considérations d’un autre temps) mais les artistes l’accompagne, paradoxalement, d’une kyrielle d’explications en tout genre « sur leurs intentions, leurs idées, leurs proclamations ». Ellul cite à ce propos le critique Leonid Andreev qui affirmait en 1967 dans la Literatournaya Gazeta, à propos du groupe Tel Quel : « L’art devient le privilège de techniciens experts. On s’acharne à compliquer… L’œuvre se transforme en produit de laboratoire. » Le rapport au spectateur est ainsi biaisé car en faisant reposer la définition du beau (tout du moins de la redéfinition de ce que les artistes contemporains nomment « le beau ») sur un plébiscite (le public doit adhérer massivement) on substitue le critère démocratique par le critère technicien : « est validé ce qui réussit, exclusivement. »
Pour Ellul, la revendication de la liberté absolue de l’artiste qu’implique le mot d’ordre « tout est possible, tout est permis » n’est qu’un mépris envers le spectateur car celui-ci n’a pas les codes pour comprendre la démarche du créateur et les logiques complexes qui structurent son œuvre. De même que l’hypocrisie des artistes révolutionnaires subventionnés, en réalité en parfait accord avec les structures capitalistes de la société : « Fêté par toutes les autorités, décoré de toutes les récompenses, admis par tous les régimes, il déclare paisiblement qu’il faut mettre la subversion partout. » Excluant le processus de symbolisation et de distanciation présent dans l’art classique, la Technique produirait ainsi « un tout idéologique à l’égard duquel l’homme ne peut plus prendre aucune distance ».
Néanmoins — et c’est, avec sa manie de rabâcher, le principal reproche que nous pouvons lui faire — « la Technique » que Jacques Ellul brandit à longueur de pages comme un mantra explicatif de la perte de sens généralisée ressemble davantage à un « gros concept » un peu balourd et systématique (pour reprendre les mots de Deleuze) qu’à la pièce majeure d’un engrenage dont les différentes strates du mécanisme auraient gagnées a être démontées avec un peu plus de nuance (tous les artistes modernes et contemporains sont, à titre d’exemple, mis dans le même sac sans discernement). Si la plupart de ses critiques font mouche, certains emportements contre l’ordinateur, la vidéo et le hi-fi font lever les yeux au ciel, de même que nombre de jugements de valeurs à l’emporte-pièce et, pire, des formules définitives qui sacrifient la rigueur analytique sur l’autel de la grandiloquence apocalyptique : « La peinture, la musique sont mortes (comme aussi la philosophie !) et nous faisons autre chose, qui n’a plus rien à voir avec la parole mais qui dérive exclusivement des moyens d’action. Le logos, la parole sont finis. […] Dans l’état actuel, il n’y a aucune issue ni pour l’art ni pour l’homme. »
Reste à savoir si cette analyse demeura pertinente dans les décennies à venir (notamment du fait de l’expansion de l’utilisation de la réalité virtuelle dans les installations muséales, de l’indévissable fait du prince du ministère de la Culture et de la bonne santé boursière des stars de l’art contemporains). Mais davantage que la soumission à la « Technique », c’est l’asservissement à une nouvelle forme de politiquement correct issu d’une certaine gauche moralisatrice qui menace aujourd’hui la liberté artistique (voire à ce sujet les travaux de Carole Talon-Hugon et d’Isabelle Barbéris). En ce sens, cette sentence de Michel Tournier, cité dans l’essai, n’a peut-être jamais semblée aussi juste : « Si par malheur l’avant-garde devait assumer une fonction politique, elle ferait régner la terreur la plus réactionnaire au nom de la révolution. Cela s’est vu. Cela se voit encore. »
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
12:40 Publié dans Littérature, Politique | Tags : mikaël faujour, leonid andreev, tout est permis, sylvain métafiot, le comptoir, l’art et la manière, l’empire du non-sens, jacques ellul | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 26 avril 2021
Florian Balduc : « Ne nous laissons pas tenter par une forme d’abandon. »

C’est en 2014 que Florian Balduc fonde les Éditions Otrante, animé d’un désir d’arpenter, au gré de ses envies, d’autres chemins que ceux de la production littéraire actuelle. S’inscrivant dans la lignée du célèbre roman gothique d’Horace Walpole (« Le Château d’Otrante », 1764), les premiers ouvrages exhumaient des spectres oubliés du répertoire fantastique et romantique (Hoffmann, Charlotte Dacre, Pétrus Borel, Lamothe-Langon, Byron…) ; tandis que ce sont des essais traitant de la représentation du paysage dans les arts, du rythme amoureux des poèmes ou de l’évolution théâtrale entre la Belle Epoque et les Années folles qui ont pris la suite d’un catalogue qui ne sacrifie rien à l’exigence.
Le Comptoir : Avant d’être une maison d’édition, Otrante était une librairie de livres anciens, manuscrits et autographes, créée en 2004. Qu’est-ce qui vous a donné envie de franchir le pas de l’édition ?
Florian Balduc : Plusieurs raisons, sans doute, et aucune en particulier… Je n’aimais pas la ou disons une tournure que prenait le marché du livre ancien, reflet de l’évolution des goûts de la société, ainsi qu’une envie de changer, de faire quelque chose d’autre ou plus simplement « à côté » puisque l’idée initiale n’était nullement de devenir éditeur. Aucune ligne prévue, aucun objectif, simplement, à l’image des libraires éditeurs des siècles précédents, publier quelques titres en marge de la librairie ancienne. Le temps consacré à la recherche pour les éditions et les ventes des différents titres ont fait évoluer la chose même si, officiellement, la librairie ancienne est toujours là.
12:20 Publié dans Littérature | Tags : béatrice munaro, serge martin, nathalie coutelet, damien ziegler, saint-léon, william godwin, fantasmagoriana, pierre magnier, édition otrante, hoffmann, charlotte dacre, pétrus borel, lamothe-langon, byron, le comptoir, sylvain métafiot, florian balduc, ne nous laissons pas tenter par une forme d’abandon | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 12 avril 2021
L’individu et le sacré : Destin de l’homme dans le monde actuel de Nicolas Berdiaeff

Poursuivant son travail d’analyse critique du monde moderne, le philosophe russe Nicolas Berdiaeff examine ici la place de l’homme sous l’autoritarisme montant des régimes politiques européens dans les années 1930 (l’ouvrage date de 1936). En scrutant particulièrement les coups de boutoir incessants de l’Allemagne nazie et de la Russie soviétique, il fait le constat amer un double mouvement, l’un entraînant l’autre dans sa chute : la déshumanisation des hommes et le déclin de la spiritualité. Ce n’est plus la liberté qui guide les hommes mais la contrainte policière, la servitude collective, la discipline matérialiste. Submergée par la propagande des concepts de race, de nationalité, de sens de l’histoire, de culture de masse ainsi que par un arsenal de techniques nouvelles, la dignité humaine se dissout dans le bain de sociétés impersonnelles et tyranniques. « C’est avec une grande facilité que la masse se prête à la suggestion et tombe à l’état de possession collective », analyse-t-il en constatant que l’Allemagne hitlérienne et la Russie communiste, à défaut de pain, gavent leurs citoyens de spectacles autant que de haine en agitant les spectres du Juif, du sous-homme, de l’ennemi de classe ou du saboteur.
Si la conscience morale personnelle est remplacée par une conscience collective, enrégimentée et militaire, il rappelle que « l’homme a toujours eu des instincts grégaires » et que seule une minorité a été capable de pensée originale personnelle et créative. D’où sa déploration du système démocratique formel qui reproduit les façons de penser routinières et moyennes des individus. Partant, opposer fascisme et démocratie lui semble superficiel si l’on considère le régime fasciste comme « la mise à jour de la dialectique démocratique », voire, en poussant le bouchon plus loin, « le résultat de la doctrine de la souveraineté du peuple de Jean-Jacques Rousseau ». Pour Berdiaeff, le caractère sacré et infaillible de la volonté du peuple souverain est un mythe analogue au mythe marxiste de la sainteté et de l’infaillibilité du prolétariat.
Défenseur d’une conception aristocratique de la culture Berdiaeff fustige par ailleurs le nationalisme en tant que « culte paien de la race, mais aussi une dévotion idolâtre envers le pouvoir », imposant un art officiel : « On ne peut pas créer consciemment et sur commande un art ou une philosophie nationale, il faut aimer la vérité, la connaissance, la beauté pour elles-mêmes. » Mais Berdiaeff s’en prend aussi aux chrétiens, responsable de la dé-spiritualisation du monde. La doctrine chrétienne de justice universelle ayant trop souvent été dénaturée par des institutions cléricales véreuses et des fanatiques intolérants ennemis de la science et du progrès, et professant davantage l’amour de Dieu que l’amour des hommes. En adoptant une attitude cruelle et inhumaine, le christianisme s’est aliéné les oppressés, les travailleurs et tous ceux cherchant à bâtir un ordre social plus juste et plus humain. En somme, « On est parvenu à rendre le christianisme ‘bourgeois’ ». Attaché à l’église orthodoxe russe, Berdiaeff estime pourtant que seule une renaissance religieuse peut permettre à l’homme de se régénérer sans sombrer dans la bestialité. La révolution qu’il appelle de ses vœux (un « socialisme personnaliste ») est donc spirituelle et morale et devra « placer la personne humaine au-dessus des idoles de la production et de la technique ». Néanmoins, et c’est essentiel, cette renaissance spirituelle sera conditionnée par l’abolition première de la misère sociale et l’esclavage économique de l’homme.
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
13:41 Publié dans Littérature, Politique | Tags : fascisme, allemagne nazie, russie soviétique, déshumanisation des hommes, déclin de la spiritualité, le comptoir, sylvain métafiot, l’individu et le sacré, destin de l’homme dans le monde actuel, nicolas berdiaeff, philosophe russe | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 06 avril 2021
L'angoisse devant l'abîme

« Mon cerveau, habitué jusqu'alors à penser en dimensions européennes, embrasse les formes grandioses des temples de Lahore, amalgame le sphinx égyptien au dragon chinois ; il écrit avec les formidables masses d'où provinrent les Pyramides, il pense dans les termes pleins et majestueux du sanskrit, dont chaque mot est un organisme vivant, car un processus mystique, pangénétique, en a fait un être, un organe sexuel géant à la force génésique incommensurable qui créa toute langue et toute pensée : une synthèse du Logos et du Karma - le Verbe de Jean, le Verbe devenu chair.
Et je me livre à une folle débauche de fantasmagories spatiales. Je suis un roi assyrien, ma haute tiare va jusqu'au ciel, ma robe, tissée de lumière est de brocart aux couleurs vives ; dans mon char frappé du croissant, je survole la misère de l'Europe, investi d'un pouvoir grandiose et d'une magnificence qui jadis jeta les esclaves à terre, le front dans la poussière et l'ordure.
Oui, j'aime la majesté muette, babylonienne, où les mots étaient rares et précieux car ils naissaient d'un acte formidable et terrible.
Oui, j'aime la violence native, titanesque, du sentiment de puissance, qui se rit des dieux, qui subjugua les hommes et le règne animal, qui fit flageller l'océan et jeter dans les fers des pays inconnus.
Oui, j'aime le fier défi de la folie, j'aime de l'homme biblique l'orgueil à la dureté de granit, né de dents de dragon, qui provoque un Dieu féroce d'un rire sardonique et, pour la première fois, ose l'outrager du nom de Satan-Jéhovah, qui arrache un rocher à la terre pour le lancer contre le ciel, contre le front d'airain du meurtrier terrible qui tourmente l'engeance faite de ses propres mains en représailles de péchés que lui-même lui a inoculés.
[...]
18:04 Publié dans Littérature | Tags : stanislaw przybyszewski, messe des morts, josé corti, sylvain métafiot, pologne, décadence, fin de siècle, l'angoisse devant l'abîme | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 31 mars 2021
Ne travaillez jamais : Le secret c’est de tout dire ! de Gianni Giovannelli

Travailler ? Pourquoi faire ? Le narrateur de ce court récit aventureux, le fripon Salvatore Messana, serait plutôt enclin à lire le Droit à la paresse de Paul Lafargue et à commettre des petits larcins en bande plus ou moins organisée que d’assister à un meeting LREM sur la revalorisation de la « valeur travail ». Comme il le dit lui-même à l’entame du troisième chapitre : « L’expérience m’avait appris que, pour vivre dignement, il ne faut pas compter sur les faveurs d’autrui, mais user soi-même d’ingéniosité et d’intelligence, sans baisser la tête comme les moutons du troupeau. »
Déjà tout jeune, alors que la guerre se termine, il s’associe avec un petit camarade pour plumer les soldats américains traînant dans les rues à la recherche de prostituées bon marché dans sa petite ville des Pouilles. Parcourant la côte en direction du nord, il est accueilli dans la communauté d’un petit village de pêcheurs, travaillera sur le bateau du brave Ferdinando Cavaliere avant de s’enfuir suite à une scandaleuse affaire d’adultère qui risquait de lui exploser au visage. Il est ensuite engagé comme marin et traverse les océans pendant près de huit ans. Mais une combine élaborée à Istanbul va le confronter à son commandant de bord qui compte bien toucher sa part du gâteau. S’ensuivent menaces, coup monté et bastonnades. Mis à fond de cale pendant plusieurs semaines, brûlé par les chaînes chauffées au soleil, Salvatore est débarqué à Dakar, soigné et rentre en Italie.
C’est à Milan qu’il mettra en œuvre son stratagème le plus élaboré, après avoir frayé avec les voyous et les flics du quartier et passé quelques jours à l’usine où il déclenchera une révolte aussi soudaine que brève puisqu’il se fera virer dans la journée. Une chose certaine, c’est que l’expérience de l’usine ancre en lui le dégoût du conformisme : « Tous les gens s’affairaient dans cette pagaille grisâtre baignant dans le smog et s’auto-conditionnaient pour travailler frénétiquement, pour ne pas être submergé par la solitude, pour justifier leurs innombrables souffrances en tant qu’individus condamnés à vendre leur temps au patron. » Ces derniers exploits se déroulent selon la technique du blitz, où comment faire cracher au bassinet les patrons en à peine quelques jours de travail, avec de la hardiesse, beaucoup de culot et, le meilleur, la loi avec soi. Nous laisserons aux lecteurs curieux le soin de démêler les fils dudit stratagème mit en place avec quelques amis harassés par le travail. La nostalgie d’un retour au pays natal se fait néanmoins ressentir chez le narrateur. L’envie d’un lopin de terre, d’une vigne rien qu’à soi, dans la bonne vieille ville de Lecce, entouré de ses proches : « Nous n’étions pas des « ouvriers » mais des déracinés auxquels la civilisation avait tout pris. »
Notons que les aventures de Salvatore Messana (initialement publiées en 1983 de manière anonyme) sont inspirées par les coups d’éclats de l’ouvrier Stabile Fioravante qui, en l’espace de vingt mois, gagna dix-sept procès contre dix-sept entreprises différentes dont il réussit à se faire licencier en empochant, au passage, de juteuses indemnités. Porté par l’appel d’air des révoltes populaires de la fin des années 1960, l’ouvrage de Gianni Giovannelli n’a pas l’ambition de renverser le système capitaliste (le narrateur se défend d’être un militant) mais, plus modestement et drôlement, à faire connaître les failles juridiques permettant de récupérer une partie des gains des puissants injustement gagnés sur le dos des travailleurs : « Je ne me sentais pas le courage d’aller travailler, jour après jour, soumis au contrôle et au chantage d’une société, sans même connaître, pour pouvoir mieux la détester, la sale gueule du patron. »
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
12:09 Publié dans Littérature | Tags : ouvriers, patrons, usine, stabile fioravante, salvatore messana, milan, dakar, ferdinando cavaliere, italie, le comptoir, ne travaillez jamais, le secret c’est de tout dire !, gianni giovannelli | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 23 mars 2021
Vincent Roussel : « L’œuvre de Bertrand Blier est frappée d’oubli et d’indifférence. »

Qui connaît encore Bertrand Blier ? Ce nom évoque-t-il un panel d’images chez les moins de trente ans ? Les répliques des Valseuses ou de Tenue de Soirée sont-elles audibles dans les foyers biberonnés au streaming ? Conjurer l’oubli qui guette le cinéaste octogénaire (ainsi que les visions réductrices qui lui sont associés) c’est un des objectifs que s’est fixé le critique de cinéma Vincent Roussel à travers la monographie qu’il lui consacre : « Bertrand Blier, cruelle beauté » (Marest éditeur, 2020). Remontant le fil de ses souvenirs personnels, il ragaillardit – film par film, et avec chaleur mais sans flagornerie – un cinéma en guerre contre le conformisme et les conventions bourgeoises, aux saillies truculentes et dont les bourrasques provocatrices cachent bien souvent des cœurs fragiles empreints d’angoisse et de tendresse.
Le Comptoir : On réduit souvent ses films aux dialogues savoureux et à l’outrance rabelaisienne. Pourtant, dès son premier film, Hitler, connais pas (1963), Blier joue avec le montage pour donner l’illusion d’une interaction entre les jeunes gens qui sont interviewés séparément. Le spectacle est-il toujours la fonction première de sa mise en scène ? Comment évolue-t-elle au fil des ans ?
 Vincent Roussel : Je ne sais pas si le mot « spectacle » est le plus approprié mais on a effectivement tendance à oublier que Blier n’est pas qu’un simple dialoguiste et qu’il a toujours cherché à excéder les limites imposées par ses scénarios par une approche toute personnelle de la mise en scène. Pour ce qui est de son évolution, il est bon de rappeler qu’après une tentative ratée d’adaptation littéraire (un projet autour de L’Écume des jours de Vian), Blier a écrit tous ses films. L’écriture est donc primordiale chez lui et il ne faut pas oublier que Les Valseuses (1974) fut d’abord un roman et un grand succès de librairie. D’ailleurs, lorsqu’il évoque le sujet dans ses entretiens, le cinéaste considère que c’est à partir de Beau-père (1981) qu’il s’est vraiment intéressé aux questions de mise en scène (il juge d’ailleurs le film trop « sophistiqué » et regrette que le metteur en scène ait vampirisé l’auteur).
Vincent Roussel : Je ne sais pas si le mot « spectacle » est le plus approprié mais on a effectivement tendance à oublier que Blier n’est pas qu’un simple dialoguiste et qu’il a toujours cherché à excéder les limites imposées par ses scénarios par une approche toute personnelle de la mise en scène. Pour ce qui est de son évolution, il est bon de rappeler qu’après une tentative ratée d’adaptation littéraire (un projet autour de L’Écume des jours de Vian), Blier a écrit tous ses films. L’écriture est donc primordiale chez lui et il ne faut pas oublier que Les Valseuses (1974) fut d’abord un roman et un grand succès de librairie. D’ailleurs, lorsqu’il évoque le sujet dans ses entretiens, le cinéaste considère que c’est à partir de Beau-père (1981) qu’il s’est vraiment intéressé aux questions de mise en scène (il juge d’ailleurs le film trop « sophistiqué » et regrette que le metteur en scène ait vampirisé l’auteur).
Pourtant, on perçoit dans ses œuvres précédentes un style qui n’appartient qu’à lui : un goût pour les ellipses qui dynamisent le récit, une manière d’enfermer les personnages dans un cadre rigide (baies vitrées, grilles…) et de jouer sur la présence inquiétante du hors-champ (dans Buffet froid, par exemple). À partir de Trop belle pour toi (1989), ses mises en scène deviennent de plus en plus morcelées, elliptiques et déconcertantes (glissements oniriques, film dans le film, télescopages spatio-temporels…). Mais elles participent toujours, à mon sens, d’une volonté de ne pas se cantonner à une simple illustration de scénarios très écrits.
« Blier déteste avant tout le conformisme et l’ennui. »
09:30 Publié dans Cinéma | Tags : les valseuses, trop belle pour toi, buffet froid, georges lautner, marest éditeur, beau-père, hitler connais pas, cruelle beauté, comme un torrent, notre histoire, depardieu, le comptoir, sylvain métafiot, vincent roussel, l’œuvre de bertrand blier est frappée d’oubli et d’indifférence, si j'étais un espion, la femme de mon pote, merci la vie, tenue de soirée, calmos, jean rochefort, jean-pierre marielle, combien du m'aimes, sexisme | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 08 mars 2021
Contes matois : Le Plaisir après la Peine

Manuscrit du XVe siècle rédigé en turc ottoman, Le Plaisir après la peine (Faradj ba’d al-shidda), fait partie — avec Les Ruses des femmes d’al-Hawrânî — des deux œuvres qui inspireront l’orientaliste François Pétis de La Croix, élève d’Antoine Galland, pour la rédaction de son livre Les Mille et Un Jours (5 volumes publiés entre 1710-1712). Fort de sa maîtrise de l’arabe, du persan, du turc et de l’arménien du fait de ses dix années passées en Orient, Pétis de La Croix rédigea également une version française du Zafarnameh (1425) ou Histoire de Tamerlan du poète persan Sharafaddin Ali Yazdi, qui fut publiée à titre posthume (4 volumes entre 1722 et 1723). Ce petit volume réunit ici trois contes sur les quarante-deux que compte le texte original.
Tout commence par la prédiction d’un astrologue à deux futurs parents inquiets : la fille qui naîtra sera une démone, rusée, intelligente mais terriblement roublarde. Le vieux savant avait raison : Dellé, c’est le nom de la jeune fille, devient orpheline dès sa naissance, commet de nombreux larcins une fois grande, trouve un mari aussi fourbe qu’elle et provoque, par ses filouteries répétées, la colère du cinquième calife abbasside Hārūn ar-Rašīd (« le bien guidé »). « Les ruses de Dellé » ouvre ainsi ce petit recueil d’histoires avec malice. Dellé et ses filles dépouillent un amoureux, piègent un ânier chez le dentiste, se moquent d’un vieil aveugle faisant l’aumône, détroussent le poète Abou Doulama, dérobent la corbeille de noces d’une fraîche mariée, se jouent du richard Ali Qouthni et volent même des voleurs en se faisant passer pour des goules. Tant et si bien que le commandeur des croyants s’en trouve désespéré : « Je ne sais quelles mesures prendre pour mettre un terme aux déprédations de cette exécrable créature ! » Et bien que la morale réprouve ses actes, impossible de ne pas trouver sympathiques les astucieuses manigances de cette coquine.
Construite comme une suite de récits enchâssés les uns dans les autres l’« Histoire de Taher et de ses frères » débute, elle, par les mésaventures de Taher, négociant à Basra, dépouillé par ses trois méchants parents alors qu’ils voguaient au large. La parole revient ensuite à son esclave, Qamr-el-Behar, qui raconte son enlèvement par le frère aîné de Taher et poursuivie par ses deux propres frères, souverains de l’île d’Anqa (le thème de la méchanceté des frères est récurrent). Après une escapade en mer, les deux amants sont capturés par des pirates et Qamr-el-Behar devient la prisonnière du roi de l’île d’Irem. Taher entreprend de la libérer des griffes du monarque en demandant l’aide de la sorcière Chemset qui commande aux animaux…
Le dernier récit narre, quant à lui, les aventures d’un architecte de la ville de Bim, en Kerman (Iran), de sa femme et des trois vizirs envieux du sultan de Guvachir. Chargé par le souverain de construire un kiosque et un palais, le bâtisseur accompli sa tâche avec la plus grande maîtrise, élevant le plus beau des imarets et recevant, en gage de son travail, les honneurs et les richesses de la cour. Mais les trois vizirs du sultan, jaloux et haineux, intriguent pour déchoir l’architecte de sa gloire en utilisant sa femme dans l’affaire. Mal leur en prendra car cette dernière retourne ingénieusement le piège contre eux… Récit à la visée édifiante, il sermonne que l’avidité et la calomnie ne sont jamais récompensées. En ce sens, les lamentations des trois vizirs déchus pourraient inspirer quelque humilité à nos puissants d’aujourd’hui : « La haine et l’envie ont causé notre perte ; où en sommes-nous arrivés ? Quelle situation est la nôtre ? À quoi nous servent notre richesse et notre haut rang ? »
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
mercredi, 24 février 2021
Déflagration spirituelle : Violence & Peace de Shinobu Kaze

Issu du gag-manga type Shonen Jump, Shinobu Kaze (de son vrai nom Tomoaki Saito) a longtemps été l’assistant de Gō Nagai (Devilman, Goldorak) avant de mettre son talent de dessinateur, au mitan des années 1970, au service de genres plus radicaux : science-fiction, horreur et polar. Il ne cache pas que ses trois principales références sont les films de Bruce Lee, les flics décomplexés de Seijun Suzuki et les bandes-dessinées rock’n roll de Philippe Druillet. Trop hermétique au public japonais, il collabora, dans les années 1980, aux magazines de comics américains Heavy Metal et Epic Illustrated.
Violence & Peace est une anthologie d’histoires courtes prenant le plus souvent place dans un futur apocalyptique où des individus paumés ou réfractaires parcourent des paysages dévastés, jonchés de cadavres, côtoyant des infrastructures cyclopéennes et des machines ultra sophistiquées et minutieusement détaillées. Le recueil s’ouvre sur le récit de l’homme le plus puissant du monde qui, armé de son sabre et de sa guitare électrique, part à la recherche d’une arme ultime « capable de faire disparaître l’angoisse elle-même » (Violence becomes tranquility)… Ailleurs, c’est un policier manchot qui lutte contre le programme totalitaire d’un gouvernement ayant décidé d’éradiquer toute violence sur terre en créant une force d’unité spéciale (L’annihilateur). Plus loin c’est une scientifique qui avale une pilule d’accélération et évite un avion de chasse en l’espace de 2,2 secondes (La femme supersonique). L’on identifie çà et là des thèmes bien connus de la SF et du cyperpunk : la fusion/répulsion du corps humain et de la machine, les expériences scientifiques incontrôlées, le basculement dans des réalités alternatives, la transmutation des genres sexuels, les dictatures planétaires, l’exploration des tréfonds de la conscience humaine… Mais Kaze est aussi prolixe dans le shojo horrifique et paranormal, « subvertissant les conventions du manga pour filles » comme le rappelle Léopold Dahan sans la postface. Que ce soit à travers la détresse d’un homme confronté à l’amour surnaturel de deux jumelles dont l’une d’elle prend possession du bébé de l’autre afin de l’éventrer de l’intérieur (Réincarnée par amour) ; ou la vengeance d’une médium qui va arracher le cœur d’un criminel sadique en voyageant dans les souvenirs de sa sœur (Mort du tueur en série).
Le plus fascinant reste néanmoins ses envolées mystiques totalement grandiloquentes, comme à la fin d’Écoute la voix de ton cœur, où après une longue période de destruction causée par des rêves étranges (les gens… explosent !), l’Humanité, sous l’égide d’anges et de guitaristes new-age, évolue en une conscience unique qui transcende le monde entier et vainc le mal dans un tourbillon d’énergie cosmique. Très en vogue dans les années 1980, cette cosmogonie futuriste se retrouvera dans des œuvres comme Akira de Katsuiro Otomo (1982), Ken le Survivant de Hara et Buronson (1983) ou Galaxy Express 999 de Leiji Matsumoto (1977). Explorant deux facettes fondamentales de l’être humain (littéralement Violence and Peace), Kaze se fait l’artisan du chaos pour mieux prêcher un idéal d’amour universel et un sursaut écologique. Les horreurs décrites sont bien souvent le résultat des guerres passées, tel ce spectre, mort lors des bombardements de Tokyo, qui hante le corps d’une lycéenne et pleure sa rage d’avoir été fauché dans sa jeunesse (Les larmes du spectre). Dans une autre histoire, un lycéen poussé au suicide se venge de ceux qui le harcelait en prenant possession de l’un d’eux et sème la mort autour de lui (Angel’s Eye). Ou c’est un miroir magique qui, à la manière du portrait de Dorian Gray, reflète l’état mental et la blessure sentimentale d’une jeune voyante.
Graphiquement, enfin, c’est d’une virtuosité folle. Sa maîtrise du dessin autant que son audace du découpage sont impressionnantes. Malgré le luxe de détails que peut contenir une seule case ou une double page, les séquences, bien que narrativement complexes, n’en demeure pas moins lisibles. Atteint d’une véritable emphase graphique, il construit ses planches comme un sculpteur taille dans le marbre, conférant à ses cases des formes géométriques recherchées et déroutantes, et dont l’originalité reflète bien souvent les états d’âme des personnages. Cette case déchirée par le tir d’un colt 45, par exemple, symbolise la crise et le désespoir d’un adolescent face à une vague délirante de suicides dans son collège (Le garçon au colt 45). La ligne du visage apaisé qui conclue l’histoire Heart and Steel semble, quant à elle, d’une perfection irréelle. Même apaisés, les méandres imaginaires de Shinobu Kaze sont un voyage sans retour.
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
10:11 Publié dans Littérature | Tags : futur apocalyptique, tomoaki saito, heart and steel, le comptoir, manga, sylvain métafiot, déflagration spirituelle, violence & peace, shinobu kaze | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 17 février 2021
Le mécano de la sociale : La Mécanique Lucas Belvaux de Louis Séguin et Quentin Mével

Dans le petit et dense essai qui précède le passionnant entretien avec Quentin Mével, Louis Séguin rappelle quelques traits caractéristiques du cinéma de Lucas Belvaux comme l’importance accordée à la parole (qu’elle soit dialoguée ou monologuée) mais aussi aux gestes silencieux dont la signification s’avère souvent cruciale dans l’avancement du récit. La mise en scène des corps porte ainsi l’histoire autant que le scénario : « Les films de Lucas Belvaux sont des théâtres, dont chaque personnage peut être tour à tour acteur ou spectateur ».
Ancrant ses récits dans des lieux qu’il connaît bien (les friches industrielles du Nord de la France, Charleroi, Le Havre, Liège et ses environs), jonglant aisément avec les genres (polar, comédie, drame… avec des réussites inégales), son point de vue se veut réaliste, observant d’un œil critique la misère sociale qui pousse au crime (La raison du plus faible), la démagogie politique qui prospère sur la peur (Chez Nous), la lâcheté ordinaire qui confronte la culpabilité personnelle au jugement de la société (38 Témoins), le fossé entre classes malgré l’amour (Pas son genre), la froide logique des intérêts bien compris (Rapt), les traumatismes de la guerre (Des hommes) ou encore le déclassement social, la culture ouvrière et les luttes syndicales. Chez Belvaux regarder la réalité en face c’est refuser le déni, porter un jugement, prendre parti, s’engager, quitte à rompre avec son entourage. D’où une dimension militante et éthique dans sa façon de filmer qui interroge les tourments moraux de personnages parfois antipathiques (grand patron, militants d’extrême droite…) permettant de comprendre tous les ressorts de l’intrigue. Il plane ainsi une sorte de déterminisme sur chacun d’eux, comme s’il était impossible d’échapper à leur condition sociale.
Ces thématiques se retrouvent dans l’entretien que le cinéaste a accordé à Quentin Mével et qui revisite, éléments biographiques à l’appui, toute sa filmographie de manière chronologique. L’on apprend ainsi que ses premiers pas en tant que réalisateur sur Parfois trop d’amour (1993) furent plus délicats quant à la direction d’acteurs que dans l’apprentissage de la caméra ou du découpage. Lui qui avait travaillé en tant qu’acteur pour Żuławski, Chabrol, Assayas ou Boisset avait eu le temps de s’instruire sur le tas des ficelles du métier mais il a dû apprendre, une fois derrière la caméra, à revendiquer et maintenir ses choix, parfois avec autorité. Belvaux se livre avec sincérité et, au détour de considérations sur les divers problèmes qu’entraîne la production d’un film (notamment sur sa trilogie mélangeant trois genres différents et tournée dans le désordre : Un couple épatant, Cavale et Après la vie en 2003), on apprend également que la rencontre entre Jean-Pierre Léaud et Ornella Muti sur Pour rire ! (1996) fut pour le moins surprenante et que c’est elle qui l’adouba en tant que metteur en scène. Il saisi l’occasion pour faire la différence entre la réalisation (« la technique, tu décides où mettre ta caméra, comment tu la fais bouger ») et la mise en scène (« le théâtre, comment tu fais bouger les acteurs dans un cadre ou un espace »). Côté technique il porte un amour particulier aux plans-séquence, aux travellings et au format scope. Côté personnages il mélange sans peine les univers de Jean-Pierre Melville, Ken Loach ou Fritz Lang. Et s’il passe un certain temps à se documenter avant de s’engager sur un projet, il n’hésite pas non plus – comme en témoigne ses derniers films – à imposer sa vision propre en adaptant des œuvres littéraires : La vie en jeu du Baron Empain, Est-ce ainsi que les femmes meurent de Didier Decoin, Pas son genre de Philippe Vilain, Le Bloc de Jérôme Leroy, Des hommes de Laurent Mauvignier. Pour toucher à la vérité il faut savoir prendre des libertés.
En somme, un ouvrage très instructif sur la fabrication d’un film (machine lourde et complexe s’il en est) et sur le parcours d’un cinéaste en perpétuel apprentissage : « Je me pensais de l’école de Jacques Rivette et John Cassavetes, des réalisateurs qui offrent beaucoup de place aux acteurs. En fait, je suis plus de celle de Claude Chabrol, Billy Wilder, Ernst Lubitsch ou François Truffaut, qui pensent beaucoup leurs films, en échafaudent méticuleusement la mécanique. »
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
15:46 Publié dans Cinéma | Tags : chez nous, la raison du plus faible, pas son genre, parfois trop d’amour, un couple épatant, cavale, rapt, après la vie, le mécano de la sociale, sylvain métafiot, le comptoir, la mécanique lucas belvaux, louis séguin, quentin mével | Lien permanent | Commentaires (0)