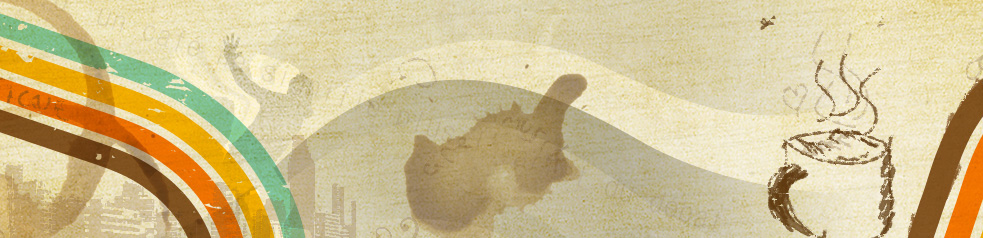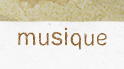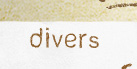lundi, 14 janvier 2019
L’homme du souterrain : The House that Jack built de Lars von Trier

Article initialement publié sur Le Comptoir
Lars von Trier aurait-il réalisé son grand oeuvre, sa grande farce macabre ? Celle qui boucle le cercle noir entamé dès Element of crime en 1984, point de départ d’une trilogie (suivront Epidemic et Europa) sur une Europe transformée en purgatoire urbain jalonnée d’histoires labyrinthiques et poisseuses. Ce n’est sans doute pas un hasard si, dans ce premier film, on entend la comptine populaire anglaise qui donne son titre au dernier long-métrage du cinéaste danois : plus qu’un indice, un memento mori filmique qui rappelle, à plus de trente ans d’écart, son obsession, teintée d’ironie, pour les pulsions criminelles et auto-destructrices nichées au cœur des hommes.
Les « incidents » qui parsèment The House that Jack built constituent les chapitres d’un conte moderne à la noirceur exacerbée et à l’humour grinçant. Construit sous la forme d’un long flash-back, Jack, le tueur psychotique et méthodique, raconte ainsi à Verge cinq meurtres avec une minutie et un détachement qui, en sus de l’horreur des actes proprement perpétrés, confinent à une drôlerie inattendue. Ainsi, des talents d’acteur et de bonimenteur de Jack pour tromper ses victimes, ses TOC qui l’obligent à nettoyer plusieurs fois la même scène de crime, son cynisme lorsqu’il avoue ses crimes à un policier indifférent, la chance insolente qui lui permet d’échapper à la justice et lave littéralement ses forfaits. S’estimant le bâtisseur d’un monument glorieux et immortel, Jack ne cesse de justifier ses actes ignobles en s’estimant le continuateur esthétique du génocide nazi, des purges staliniennes et autres massacres de masse, faisant de la « pourriture noble » son emblème oxymorique. De fait, seuls les geignards professionnels auront le tort de confondre le personnage et le cinéaste. Lars von Trier s’amuse de son anti-héros et de sa propre oeuvre. Verge, le confesseur antique de Jack, ne cesse de se moquer de son narcissisme, de son maniérisme, de ses pseudo alibis culturels, de ses rêves de grandeur. À la figure du nihilisme le plus destructeur qu’incarne Jack, Verge lui répond en tant que son adversaire humaniste, celui qui, tout en l’entraînant aux gouffres infernaux, lui fait prendre conscience de ses péchés.
Si parmi la kyrielle de références (William Blake, Dante, Delacroix, Glenn Gould, Virgile, David Bowie, le surréalisme…) on pense inévitablement à l’ouvrage de Thomas de Quincey, De l’assassinat considéré comme un des beaux-arts (1827), c’est à son Mangeur d’opium (1822) que fait songer la dernière partie du film, enchaînement de fascinants tableaux pandémoniaques ne laissant aucun doute sur le sort funeste réservé à Jack, ce « pathétique architecte raté » passé de la chambre froide du crime au neuvième cercle de l’enfer : « J’avais chaque nuit l’impression de descendre, non au sens métaphorique, mais de descendre littéralement, dans des gouffres et des abîmes sans soleil, des profondeurs infinis desquelles mon éventuelle remontée semblait désespérée. »
Sylvain Métafiot
16:14 Publié dans Cinéma | Tags : l’homme du souterrain, the house that jack built, lars von trier, le comptoir, sylvain métafiot, enfer, dante, delacroix, thomas de quincey | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 05 janvier 2019
Cimes cinéphiliques 2018
Qui succède à Laissez bronzer les cadavres ! de Hélène Cattet et Bruno Forzani au titre de meilleur film de l'année ? La réponse dans notre habituel top 10, suivi de son flop 10 tout aussi subjectif.
Au sommet cette année
1) Les Garçons sauvages de Bertrand Mandico : éloge des sorcières, des désirs sauvages et de l'androgynie suave.

2) Phantom Thread de Paul Thomas Anderson : confrontation et réunion entre la perfection formelle et l’anarchie vitaliste.

3) The House that Jack Built de Lars von Trier : l’homme du souterrain en quête de d’absolu criminel.

4) En liberté ! de Pierre Salvadori : la vie, en mieux. Et en plus drôle.

5) Seule sur la plage la nuit de Hong Sang-soo : fragments d’un exil amoureux.

21:00 Publié dans Cinéma | Tags : cimes cinéphiliques 2018, sylvain métafiot, seule sur la plage la nuit, en liberté, the house that jack built, les garçons sauvages, le poirier sauvage, hérédité, mektoub, my love, l'insulte, mademoiselle de joncquières, top 10, flop 10 | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 22 décembre 2018
Feu aux fêtes
« C’était l’explosion du nouvel an : chaos de boue et de neige, traversé de mille carrosses, étincelant de joujoux et de bonbons, grouillant de cupidités et de désespoirs, délire officiel d’une grande ville fait pour troubler le cerveau du solitaire le plus fort. »
Charles Baudelaire
~
« Meilleurs vœux !
Nous sommes parvenus à l'insupportable Noël [...], fête stupide et irréligieuse.
Meilleurs vœux aux fabricants de cadeaux païens ! Meilleurs vœux aux industriels charismatiques qui produisent des étrennes toutes semblables !
Meilleurs vœux à qui mourra de colère dans les embouteillages du trafic automobile et, peut-être, insultera chrétiennement ou poignardera chrétiennement celui qui aura osé le dépasser ou qui aura donné un coup sur le derrière de sa sainte Fiat 600 !
Meilleurs vœux à qui croira sérieusement que l'orgasme qui l'agitera - l'anxiété d'être présent, de ne pas rater le rituel, de ne pas pouvoir accomplir son devoir de consommateur - sera un signe de fête, de joie !
Mes vœux véritables, je veux les présenter à ceux qui sont en prison, quoi qu'ils aient pu avoir fait (excepté les fascistes habituels, du petit nombre qui s'y trouvent) ; il est vrai qu'il y a beaucoup de malheureux en liberté, autrement dit, beaucoup qui ont besoin de vœux véritables toute l'année (nous tous, au fond, parce que nous sommes précisément de pauvres êtres humains marchant à tâtons, avec toute notre assurance et notre sourire présomptueux). Mais je choisis les prisonniers, pour des raisons polémiques, outre qu'en vertu de certaine sympathie naturelle découlant du fait que, le sachant ou ne le sachant pas, le voulant ou ne le voulant pas, ils demeurent les uniques vrais contestataires de la société. Ils appartiennent tous à la classe dominée, et leurs juges appartiennent tous à la classe dominante. »
Pier Paolo Pasolini
12:56 Publié dans Insolite | Tags : nouvel an 2018, charles baudelaire, chaos | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 12 décembre 2018
Jean-François Rauger : « Sergio Leone a engendré un genre dont il a inventé l’essentiel de l’esthétique »

Article initialement publié sur Le Comptoir
Ses films sont vus et revus avec le même enthousiasme depuis 60 ans, il a inspiré des dizaines de cinéastes à travers le monde, ses personnages sont devenus des icônes de la culture populaire, sa mise en scène est étudiée dans toutes les écoles du cinéma, ses gros plans mille fois reproduits, et la musique de son ami Morricone résonne dans le cœur de toute une génération de spectateurs. À travers seulement sept films, Sergio Leone, longtemps méprisé par ses pairs, ne s’est pas contenté de réanimer avec panache un genre essoufflé, celui du western. Il a démontré que le cinéma, cet art alchimique par excellence, pouvait combiner, sous l’égide d’une Amérique fantasmée, la violence lyrique la plus stylisée avec une sensibilité intimiste et morale extrêmement raffinée. À l’occasion de l’exposition et de la rétrospective que lui consacre la Cinémathèque française nous nous sommes entretenu avec son directeur de la programmation, Jean-François Rauger.
Le Comptoir : C’est aujourd’hui entendu, Sergio Leone est un grand parmi les grands. Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi. Au début des années 60′, « Western spaghetti », avant d’être un étendard revendiqué, était une insulte proférée par des critiques n’acceptant le renouveau tapageur et moderne d’un genre qu’ils considéraient comme exclusivement américain. Pourquoi une telle levée de boucliers ?
Jean-François Rauger : Il y a eu un soupçon pesant sur la légitimité du western italien comme un genre détaché de toute racine culturelle. Mais pourquoi le cinéma ne pourrait-il pas, justement, trouver d’autres racines culturelles que celles légués par une certaine Histoire et une certaine géographie ? Ce fut un réflexe fétichiste et mélancolique à la fois, le constat de la disparition d’un moment de l’histoire du cinéma si bien incarné par le western américain et ses transformations successives. Ce fut aussi le refus de voir que la forme « dégradée » que représentait le western italien pouvait faire partie d’une forme de modernité tout comme la prédominance de la sensation sur le sens, du jeu sur la psychologie, a pu apparaître comme une forme de pornographie.

12:07 Publié dans Cinéma | Tags : jean-françois rauger, sergio leone, sylvain métafiot, le comptoir, il était une fois en amérique, le bon la brute et le truand, western spaghetti | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 19 novembre 2018
Prophétie d’apocalypse : En attendant la fin du monde de Baudoin de Bodinat

Article initialement publié sur Le Comptoir
Désespérons, oui, mais avec style. « & maintenant à se donner le beau rôle de “sauver la planète” – prétention inconvenante, d’abord ridicule et vouée à l’échec si c’est à y employer ce même rationalisme à qui nous devons d’en être arrivés là sous la conduite de la passion lucrative, qui entend spéculer habilement sur l’apocalypse elle-même, accumuler bonus et dividendes au seuil même de son néant. Tout au plus s’agirait-il de sauver quelques meubles de notre monde humain – mais c’est comme un incendie de maison : il y a un certain point de ronflement du brasier marquant l’inutilité de continuer à s’agiter. Des mondes, la planète s’en fera d’autres ; comme c’est à la faveur d’autres extinctions que nous devons d’être entrés dans la carrière. »
De toute évidence, Baudoin de Bodinat n’est pas de son époque. Écrivain d’une discrétion absolue, antimoderne tellurique, né trop tard dans un monde ayant tôt fait de remplacer les anciennes féodalités traditionnelles par de nouveaux asservissements modernes, c’est d’une langue ciselée (quoi que parfois trop alambiquée) sur la pierre noire des moralistes du XVIIe siècle qu’il découronne tous les dégoûts que lui inspire son temps et que la plupart de nos contemporains, paradoxalement englués dans la frénésie techno-sociale, ont passivement acceptés comme état de fait quand ils n’en chantent pas bruyamment les louanges : « l’existence confortable administrée et sous vidéosurveillance, l’abreuvement continu au flux des divertissements dispensés par les fermes de serveurs et à celui des idioties récréatives du réseau, l’épanouissement béat de la mondialisation heureuse, son indifférence à tout ce qui n’est pas son propre miroir, la conviction qu’elle entraîne de sa perfection, de son progrès inévitable, de ses roues bien huilées. » Ce qu’il faut bien comprendre c’est que cette litanie des nuisances, déroulée d’une amer ironie, non content de ravager l’environnement naturel du globe, n’est pas non plus sans effet sur l’homme mais participe bien d’une « atrophie ou une déchéance de la faculté sensible ». Nous devenons étranger à nous-mêmes et aux choses qui nous entourent.
Par contraste, l’ouvrage est agrémenté de photographies, d’un noir et blanc d’une belle sobriété, d’un petit village indécis et tortu, perdu dans un coin reculé du pays où les heures vides de l’ennui reprennent leur droit sur le cours débridé de la vie sociale. Le silence véritable est assurément une vertu permettant de retrouver la saveur sensible de l’air et des êtres, de « s’ennuyer parmi le monde des choses avec ses lointains, ses échos infimes en soi-même, résonances où l’esprit se cherche parmi les sensations, se livre à des imaginations. » Pour qui partage la douloureuse sensation d’être complètement (ou en partie) étranger aux turpitudes du monde actuel trouvera en Baudoin de Bodinat la complicité d’un frère en neurasthénie. Les autres renouvelleront leur abonnement au Nouvel Obs.
Sylvain Métafiot
14:14 Publié dans Littérature, Politique | Tags : prophétie d’apocalypse, sylvain métafiot, le comptoir, antimoderne, en attendant la fin du monde, baudoin de bodinat | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 13 novembre 2018
Priape va à l’école : Petit Paul de Bastien Vivès

Article initialement publié sur Le Comptoir
« Petit Paul est bien ennuyé… » est-il inscrit sur la 4e de couverture. Il faut dire qu’avec l’anaconda qu’il se trimbale dans le calebar ce n’est pas évident de vivre comme un petit garçon de son âge. Surtout quand, avec une candeur des plus touchantes, il en vient à se fourrer dans des positions plutôt inconfortables. La découverte d’un smartphone débouche ainsi sur une partouze des plus bigarrée ; un entraînement de judo vire à la réinvention acrobatique du kamasutra ; tandis qu’une récitation de poésie transforme le petit oiseau de Paul en lance à incendie. Mais l’on découvre aussi que des sex-toys peuvent se nicher dans l’étable des vaches et que dans les stations-services, ma bonne dame, il s’en passe de drôles dans les toilettes des femmes. Bref, Bastien Vivès s’éclate et nous avec. Rien n’entrave son imagination délicieusement perverse et sa dérision corrosive : les vieux, les jeunes, les frères, les sœurs, les voisins, les profs, les moutons et même les vaches, tout le monde s’envoie en l’air dans une folie sexuelle aussi débridée qu’hilarante. Comme le dit Céline Tran dans la préface : « Sexe et humour peuvent définitivement faire bon ménage, surtout lorsqu’il s’agit de transgresser. » L’exagération des situations confine à l’absurde le plus drôle. Si chaque petite récit commence normalement, le réalisme est rapidement biflé par une incongruité salace aussi fraîche qu’irrévérencieuse. En somme, ça part littéralement en couille. Et il n’en fallait évidemment pas plus pour que les tenants de l’ordre moral et du bon goût, puritains de droite ou bien-pensants de gauche, se mettent à éructer en agitant les bras et en soufflant du nez. À toute fin utile leur permettant de se détendre les fesses nous leur conseillons donc de se faire allègrement cuire le cul.
Pour en revenir à notre auteur polisson, il faut noter qu’en sus de ses publications plus « graves » et « réalistes » (Le Goût du Chlore, Polina, Une sœur, Le Chemisier…) Vivès n’en est pas à son coup d’essai dans le domaine érotique puisqu’il a déjà signé deux œuvres fantasques dans l’excellente collection « BD Cul » des éditions Les Requins Marteaux : Les Melons de la colère (2013), revenge-porn rural dans lequel Magalie, jeune fermière aux seins énormes (et accessoirement sœur de Petit Paul), se fait abuser par tous les notables du village ; et La Décharge mentale (2018), narrant la conception fort particulière qu’une famille de nymphomanes a d’offrir le gîte et le couvert à ses invités. Extravagances narratives, attributs démesurés, amoralité joyeuse, on aura compris que chez Bastien Vivès la chair n’est pas triste et le rire se dilue merveilleusement bien dans les fantasmes les plus inavouables.
Sylvain Métafiot
10:28 Publié dans Insolite | Tags : le comptoir, érotique, sylvain métafiot, fantasque, désir, priape va à l’école, petit paul, bastien vivès, sexe, bd cul | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 31 octobre 2018
Bernard Benoliel : « “Taxi Driver” se nourrit de la folie criminelle des seventies »

Article initialement publié sur Le Comptoir
Directeur de l’action culturelle et éducative à la Cinémathèque française, ancien critique aux « Cahiers du cinéma » et auteur d’ouvrages sur Clint Eastwood et Bruce Lee, Bernard Benoliel a consacré un essai au cinquième long-métrage de Martin Scorsese : « Taxi Driver » (Yellow Now, 2017). Film fournaise marqué au fer rouge du Nouvel Hollywood qui, au cœur d’une décennie agitée de bouillonnements contestataires au sein de laquelle les œuvres de Friedkin, Polanski ou Altman ont redéfini les codes du film noir, enfièvre les rues de New York d’un hyper-réalisme hallucinatoire, d’une ultra-violence cathartique et d’un dédoublement obsessionnel.
Le Comptoir : Dès l’introduction de votre essai, vous affirmez vouloir prendre à rebours les interprétations communes sur Taxi Driver, en visionnant le film « comme dans un miroir ». Quels sont les commentaires habituellement émis sur le film et pourquoi vouloir s’en départir ?
 Bernard Benoliel : Taxi Driver est un film, à la mesure du choc provoqué à sa sortie et à chaque nouvelle vision, qui a suscité nombre d’analyses, d’interprétations, toute une glose critique très légitime, à la mesure aussi d’un phénomène essentiel : le film demeure pour une part énigmatique, il échappe à qui veut le cerner. Que peut-il bien signifier véritablement et, en particulier, comment comprendre les raisonnements et les actes de Travis Bickle, le personnage du taxi driver joué par Robert De Niro ? De ce point de vue, le film agit comme certains autres, célèbres et célébrés pour cette même raison, ce que la culture populaire appelle des films “cultes”, par exemple Vertigod’Hitchcock ou Mulholland Drive de Lynch, des œuvres avec lesquelles il est impossible d’en finir : « analyse terminée, analyse interminable », écrivait Freud en donnant bien sûr à l’analyse un autre sens qu’ici. En écrivant sur le film de Scorsese et en avançant dans son “analyse”, j’ai éprouvé ce vertige, cette spirale du sens, un vertige euphorisant car il encourage à toujours pousser plus loin, chaque fois le film répondant présent.
Bernard Benoliel : Taxi Driver est un film, à la mesure du choc provoqué à sa sortie et à chaque nouvelle vision, qui a suscité nombre d’analyses, d’interprétations, toute une glose critique très légitime, à la mesure aussi d’un phénomène essentiel : le film demeure pour une part énigmatique, il échappe à qui veut le cerner. Que peut-il bien signifier véritablement et, en particulier, comment comprendre les raisonnements et les actes de Travis Bickle, le personnage du taxi driver joué par Robert De Niro ? De ce point de vue, le film agit comme certains autres, célèbres et célébrés pour cette même raison, ce que la culture populaire appelle des films “cultes”, par exemple Vertigod’Hitchcock ou Mulholland Drive de Lynch, des œuvres avec lesquelles il est impossible d’en finir : « analyse terminée, analyse interminable », écrivait Freud en donnant bien sûr à l’analyse un autre sens qu’ici. En écrivant sur le film de Scorsese et en avançant dans son “analyse”, j’ai éprouvé ce vertige, cette spirale du sens, un vertige euphorisant car il encourage à toujours pousser plus loin, chaque fois le film répondant présent.
Alors oui, dans le préambule du livre, j’ai voulu résumer très vite le sens des commentaires majoritaires sur Taxi Driver, des commentaires qui parfois s’excluent ou s’opposent, ce qui de fait n’est pas étonnant, mais des commentaires qui, à force, ont tendance à figer le film et singulièrement Travis Bickle, un personnage qui se retrouve enfermé dans le tableau des psychoses – un portrait clinique qui encore une fois a sa part de vérité (le film est très “accueillant”) – et un personnage alors devenu seulement le révélateur d’une société déboussolée et criminogène. J’ai voulu assurément “libérer” Travis, le rendre à sa complexité ou à sa dualité.
On a beaucoup écrit aussi de Taxi Driver, sorti en 1976, qu’il faisait, à même le corps et l’âme de Travis – qui arbore plus d’une fois une veste militaire, appartenant au scénariste Paul Schrader –, le portrait d’un vétéran et témoignait d’un trauma d’après-guerre. Et même si Scorsese a déclaré : « Mon film n’est pas un commentaire sur le Vietnam. » De fait, certaines études ont fait de Taxi Driver un exemple patent de la crise de la masculinité en Occident dans les années 1970 quand d’autres ont annexé le même film pour lui faire rejoindre le corpus des vigilante movies, soit l’expression du retour d’une hyper virilité toujours en Occident et toujours à la même période.
De même, le film et le personnage, indissociables, ont beaucoup été lus à l’aune du catholicisme de Scorsese et du protestantisme de Schrader quand le réalisateur et le scénariste, pour leur part, ont souvent qualifié Travis de kamikaze, de samouraï ou de rônin, et même si Scorsese a dit une fois, nous aidant à mon sens à nous mettre sur le chemin du vrai Travis : « Travis, c’est la toute-puissance de l’esprit, mais sur le mauvais chemin. »
« On ne comprend rien à Taxi Driver si on refuse de voir que le film est traversé, travaillé en permanence par un “irréalisme”, un sur-réalisme ou un hyper réalisme qui confine au “gothique”, comme l’exprimait Scorsese, ou au fantastique. »
C’est cette piste que j’ai suivie, celle qui m’a paru la plus féconde et capable de renouveler une approche un peu en boucle du film, aidant à retourner ou renverser le sens, comme notre image s’inverse dans un miroir et comme celle du vrai Travis surgit dans la scène cruciale du miroir de Taxi Driver (« You talkin’ to me ? »). Et c’est précisément ma vision de cette scène névralgique qui m’a donné l’idée de proposer un renversement du sens du film. Ce faisant, il y avait la volonté aussi de rappeler les possibles puissances de l’analyse cinématographique tant je crois à une “politique du film”, à savoir qu’un film est le document primordial et qu’il en sait plus long que son auteur, ou ses auteurs en l’occurrence puisque ici on parle d’une création tricéphale, résultat de la volonté convergente de Scorsese, Schrader et De Niro, tous les trois sur une même longueur d’onde.
10:25 Publié dans Cinéma | Tags : le comptoir, sylvain métafiot, bernard benoliel, taxi driver, robert de niro, folie criminelle des seventies, martin scorsese, paul schrader | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 04 octobre 2018
Pièce et Main-d'Oeuvre : "La fabrication de post-humains créera deux espèces d'humanité."

Article initialement publié dans le 1er numéro de La Revue du Comptoir
Se réclamant des luddites anglais du XIXe siècle, ces ouvriers anglais qui sabotaient leur travail en détruisant les métiers à tisser, les citoyens anonymes de l’atelier grenoblois Pièces & main-d’oeuvre (PMO) luttent depuis quinze ans contre l’emprise grandissante de la tyrannie technologique sous ses formes les plus diverses : téléphone portable, surveillance généralisée, puces RFID, nanotechnologies, biométrie, transhumanisme, manipulations génétiques, etc. Considérant la technologie comme la continuation de la guerre, c’est-à-dire de la politique, par d’autres moyens, ils ne cessent de produire des enquêtes critiques publiées aux éditions L’échappée et sur leur site, afin de combattre cette nouvelle industrie de la contrainte. Leur mot d’ordre ? « Brisons les machines ! »
Le Comptoir : Lors de votre manifestation au forum TransVision – un cycle de conférences consacrées au transhumanisme qui se tenait à l’ESPCI ParisTech – vous distribuiez l’Appel des chimpanzés du futur. Ce tract faisait écho à la déclaration d’un transhumaniste désormais célèbre, l’universitaire britannique Kevin Warwick, qui a déclaré qu’à l’avenir, « ceux qui décideront de rester de [simples] humains et refuseront de s’améliorer, auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. » Que voulait-il dire ? Pourquoi refuser cette « amélioration » ?
Pièces & main-d’oeuvre : Les transhumanistes sont les héritiers du courant eugéniste qui, dans les années 1930, prônait l’”amélioration” de l’espèce par la sélection biologique des individus, à l’instar du biologiste Julian Huxley (frère d’Aldous), inventeur du mot ”transhumanisme”. Leur projet est identique : remplacer l’évolution naturelle par une mutation artificielle, dirigée. Dépasser les « voies anachroniques de la sélection naturelle », comme dit le généticien fondateur du Téléthon, Daniel Cohen, pour fabriquer en laboratoire l’espèce qui nous remplacera. Une espèce hybride, mi-organique, mi-cybernétique (cyborg), prétendument ”augmentée” par l’incorporation de dispositifs technologiques. Les transhumanistes revendiquent le droit de façonner leur corps à leur guise, afin d’en améliorer les ”performances” physiques, sensorielles, cognitives, émotionnelles, pour, finalement, tendre vers l’immortalité. Les technologies convergentes – nanotechnologies, biotechnologies, informatique, sciences cognitives – produisent déjà des ”pièces” de l’homme-machine : implants, prothèses, organes artificiels, interfaces électroniques. Le transhumanisme n’est plus seulement une idéologie : il est à la fois le produit du techno capitalisme contemporain et un promoteur du progrès technologique. Aussi, de gauche à droite, les progressistes applaudissent ces ”avancées de la science”, sources de croissance et de puissance.
Comme l’eugénisme biologique, l’eugénisme technologique sélectionne les individus : les ”augmentés” et les ”diminués”. Les derniers correspondant à la sous-espèce de Kevin Warwick : ceux qui ne pourront ou ne voudront pas devenir cyborgs. De facto, la fabrication de post-humains créera non pas une humanité à deux vitesses, mais deux espèces d’humanité. On sait ce qu’il advient des soushommes dans une société de surhommes, d’Übermenschen ; et des chimpanzés dans un monde anthropisé – chasseurs, agriculteurs, citadins. Afin de ”s’améliorer”, les transhumanistes rejettent leur histoire naturelle pour devenir des artefacts, dépendants de leurs concepteurs, fabricants et vendeurs. Quitte à détruire l’universalité de la condition humaine au profit d’un chaos asocial, où chacun s’auto-conçoit selon son désir et où nul ne se reconnaît en personne. Pour eux, l’humain est l’erreur : fragile, faillible, soumis au hasard de l’évolution. Leur toute-puissance doit élargir l’emprise sur l’espèce. Leur volonté doit soumettre le processus évolutif pour lui substituer un ”fonctionnement machinique”, optimisé et sous contrôle : totalitaire. Ayant fait de cette planète un monde-machine, une cyber-sphère, les technocrates s’emploient à la peupler d’hommes-machines, suivant l’injonction du cybernéticien Norbert Wiener, en 1945 : « Nous avons modifié si radicalement notre milieu que nous devons nous modifier nous-mêmes pour vivre à l’échelle de ce nouvel environnement. » Avant, espèrent-ils, d’aller coloniser d’autres planètes, selon la politique de la ”Terre brûlée”.
L’Appel des chimpanzés du futur évoque cet élan historique qui, depuis plus d’un siècle, a vu converger dans un même mouvement la technologie et le totalitarisme. Quels que soient les régimes, la technocratie fait de la puissance techno-scientifique le moteur et le but du ”progrès”. Ce ”progrès” technologique est un regrès social et humain. Contre le transhumanisme, ce nazisme en milieu scientifique, nous devons, pour rester humains, penser et nommer les choses. Les idées ont des conséquences. Nous, animaux politiques, devons formuler les idées justes pour défendre notre humanité contre le machinisme des transhumanistes.

lundi, 06 août 2018
La banalité du bien ou la possibilité d’un altruisme radical

Article initialement publié sur Le Comptoir
Est-ce une décision initiale qui fait pencher l’individu du côté du bourreau ou du héros ? Rares sont les résolutions franches et réfléchies marquant une rupture radicale avec les conduites passées. Les actions humaines obéissent à une espèce de logique ou de continuum qui s’intègre dans la structure de la personnalité (et qui inclut un ensemble de croyances plus ou moins organisées). Malgré tout, il existe bien une “première fois”, un acte inaugural qui ouvre soit à la docilité soit à la résistance. Et ce “premier acte” est d’une importance décisive parce qu’il est rare que l’on revienne en arrière, que l’on rompe avec nos manières d’être. Et si certains mettent le doigt dans l’engrenage de l’obéissance à une autorité destructrice, d’autres franchissent le pas du secours gratuit, du refus de la souffrance, de la bonté absolue.
 Depuis le XVIIIe siècle on a tendance à penser que l’Homme ne souhaite que réaliser ses propres intérêts, que le désintéressement pur n’existe pas, qu’il y a toujours un intérêt (explicite ou caché) derrière chaque action. Cela a été théorisé – notamment en économie où l’égoïsme est le postulat général de départ – par Hobbes, La Rochefoucauld, Mandeville, Bentham, Francis Edgeworth, Denis Mueller. De là découle le calcul coût/avantage du courant néoclassique. Sigmund Freud et John Rawls affirment également que l’être humain aspire uniquement à son propre bonheur sans se soucier des autres. C’est pourtant une vision réductrice des motivations qui nous poussent à aider autrui.
Depuis le XVIIIe siècle on a tendance à penser que l’Homme ne souhaite que réaliser ses propres intérêts, que le désintéressement pur n’existe pas, qu’il y a toujours un intérêt (explicite ou caché) derrière chaque action. Cela a été théorisé – notamment en économie où l’égoïsme est le postulat général de départ – par Hobbes, La Rochefoucauld, Mandeville, Bentham, Francis Edgeworth, Denis Mueller. De là découle le calcul coût/avantage du courant néoclassique. Sigmund Freud et John Rawls affirment également que l’être humain aspire uniquement à son propre bonheur sans se soucier des autres. C’est pourtant une vision réductrice des motivations qui nous poussent à aider autrui.
Si certains individus trouvent une satisfaction personnelle dans l’altruisme cela est sans doute plus le fruit du résultat des actions généreuses qu’un but préalable à ces actions. L’opposition entre un homme “idéalisé” par les sciences sociales et un homme “réel” dont les motivations échappent parfois à l’analyse rationnelle découle d’une vision quasi divine de l’altruisme : cette générosité absolue serait d’une pureté inaccessible. Le postulat égoïste est pourtant mis à mal par les jugements éthiques que nous formulons tous les jours et par les actions bienveillantes issues de ces jugements. A priori, nous condamnons fermement tous ceux que la souffrance d’autrui laisse de marbre (il en existe) et louons ceux qui se dévouent pour les autres (malgré leur rareté). Sans être des modèles de vertu, la solidarité s’exprime globalement envers tout un chacun dans la mesure du possible. Si l’intérêt n’est pas absent de l’altruisme ce n’est pas non plus son objectif final.
Adam Smith, reprenant une thèse formulée par Francis Hutcheson et David Hume, affirme, dans La Théorie des sentiments moraux, que les actions des individus s’articulent entre l’intérêt propre (amour de soi) et l’intérêt des autres (sympathie). La psycho-sociologie américaine affirme également qu’il n’y a pas de raison théorique de privilégier le paradigme égoïste pour expliquer les actions généreuses. Le postulat égoïste doit donc prouver ses dires aux vues des expériences empiriques.
Mais si l’altruisme existe bel et bien, comment se fait-il que 1% à peine de la population allemande ait résisté au nazisme ? Et que dans cet océan de passivité des individus comme Giorgio Perlasca ou André Trocmé sauvèrent des milliers de Juifs ?
lundi, 09 juillet 2018
Le tournant néo-libéral en Europe de Bruno Jobert

Article initialement publié sur Le Comptoir
Loin d’être le simple résultat de circonstances extérieures, le tournant néo-libéral qui s’inaugure au tout début des années 1980 s’explique d’abord par l’usure confirmée des modèles anciens et l’élimination rapide d’orientations alternatives. Sa permanence, en revanche, résulte plutôt des modifications en profondeur du climat intellectuel des années 1970 et son ancrage dans un grand dessein européen. L'ouvrage dirigé par Bruno Jobert montre que le processus d’imposition et d’acceptation du changement de référentiel passe par le fonctionnement différencié de plusieurs instances qu’il nomme forums. Il distingue notamment le forum de la communication politique, qui constitue une scène de construction de la réalité sociale sur laquelle vont se modifier les termes de la rhétorique politique dans un contexte de sortie de la guerre froide… Le consensus modernisateur s’efface devant une nouvelle rhétorique exaltant les gagnants de la nouvelle compétition et stigmatisant les blocages sociaux. Le discours néo-libéral adopté par la nouvelle opposition constitue dans un premier temps une stratégie de disqualification de l’adversaire au pouvoir. Ainsi, plutôt que d’opposer la droite à la gauche, il vaut mieux opposer les républicains et les socialistes.
Évoquons également l’invasion de la société française par un groupe social qui fera du néo-libéralisme anti-étatique un outil puissant d’élimination de ses concurrents : les économistes d’État. C’est une élite dirigeante dont le camp de base est le ministère de l’Économie (puissant outil de promotion s’il en est), parachevant ainsi la grande reconquête amorcée avec la constitution de la Ve République. Dans ce travail d’appropriation, l’homogénéisation croissante du discours de cette élite a joué un rôle essentiel. Dans les périodes antérieures, le pluralisme des orientations intellectuelles contrebalançait quelque peu la monopolisation des capacités d’expertise de l’État : elle autorisait un accès plus ouvert des différents acteurs du jeu social à ces ressources. L’arrivée de la gauche au pouvoir joue un rôle majeur. Dès le début du septennat de Mitterrand, on assiste à une marginalisation des recettes étatistes keynésiennes mais aussi du modèle néo-corporatiste de la deuxième gauche.
De la rencontre entre le néo-libéralisme dominant et les institutions de l’État-providence à la française va finalement résulter un compromis : ni élimination du second ni simple juxtaposition des deux réseaux de politique publique construits autour de référentiels différents. Elle aboutit plutôt à une réinterprétation de cet État-providence qui joue sur la complexité de son organisation et la polysémie de ses principes fondateurs et permet ainsi des reconstructions marquantes. L’expérience de la première cohabitation a marqué les limites du néo-libéralisme doctrinaire, plus particulièrement quand celui-ci prétend passer aux pertes et profits l’héritage de l’État-providence. En cela, on peut noter le poids des institutions. La solution qui aurait consisté à démanteler purement et simplement l’État-providence, bien que réclamée par les ultra-libéraux, n’est pas à l’ordre du jour aussi bien du fait des résistances institutionnelles et politiques que de l’attachement des Européens à leur modèle social. Dès lors, la recherche d’un système de protection sociale qui soit plus favorable à l’emploi est devenue un trait commun des réformes conduites et relayées par les analyses menées au sein de l’Union européenne.
Sylvain Métafiot
10:59 Publié dans Economie, Politique | Tags : bruno jobert, le tournant néo-libéral en europe, le comptoir, sylvain métafiot | Lien permanent | Commentaires (0)