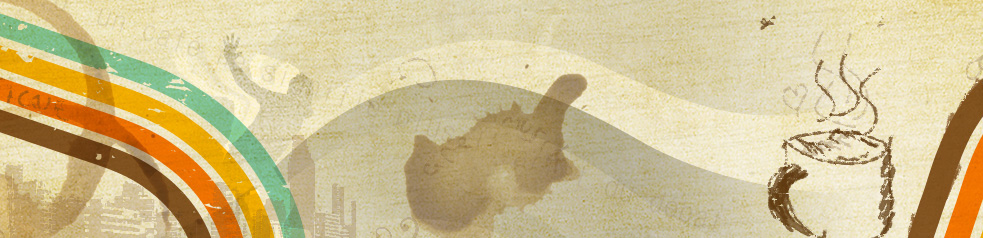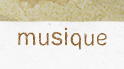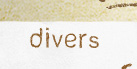mardi, 23 mars 2021
Vincent Roussel : « L’œuvre de Bertrand Blier est frappée d’oubli et d’indifférence. »

Qui connaît encore Bertrand Blier ? Ce nom évoque-t-il un panel d’images chez les moins de trente ans ? Les répliques des Valseuses ou de Tenue de Soirée sont-elles audibles dans les foyers biberonnés au streaming ? Conjurer l’oubli qui guette le cinéaste octogénaire (ainsi que les visions réductrices qui lui sont associés) c’est un des objectifs que s’est fixé le critique de cinéma Vincent Roussel à travers la monographie qu’il lui consacre : « Bertrand Blier, cruelle beauté » (Marest éditeur, 2020). Remontant le fil de ses souvenirs personnels, il ragaillardit – film par film, et avec chaleur mais sans flagornerie – un cinéma en guerre contre le conformisme et les conventions bourgeoises, aux saillies truculentes et dont les bourrasques provocatrices cachent bien souvent des cœurs fragiles empreints d’angoisse et de tendresse.
Le Comptoir : On réduit souvent ses films aux dialogues savoureux et à l’outrance rabelaisienne. Pourtant, dès son premier film, Hitler, connais pas (1963), Blier joue avec le montage pour donner l’illusion d’une interaction entre les jeunes gens qui sont interviewés séparément. Le spectacle est-il toujours la fonction première de sa mise en scène ? Comment évolue-t-elle au fil des ans ?
 Vincent Roussel : Je ne sais pas si le mot « spectacle » est le plus approprié mais on a effectivement tendance à oublier que Blier n’est pas qu’un simple dialoguiste et qu’il a toujours cherché à excéder les limites imposées par ses scénarios par une approche toute personnelle de la mise en scène. Pour ce qui est de son évolution, il est bon de rappeler qu’après une tentative ratée d’adaptation littéraire (un projet autour de L’Écume des jours de Vian), Blier a écrit tous ses films. L’écriture est donc primordiale chez lui et il ne faut pas oublier que Les Valseuses (1974) fut d’abord un roman et un grand succès de librairie. D’ailleurs, lorsqu’il évoque le sujet dans ses entretiens, le cinéaste considère que c’est à partir de Beau-père (1981) qu’il s’est vraiment intéressé aux questions de mise en scène (il juge d’ailleurs le film trop « sophistiqué » et regrette que le metteur en scène ait vampirisé l’auteur).
Vincent Roussel : Je ne sais pas si le mot « spectacle » est le plus approprié mais on a effectivement tendance à oublier que Blier n’est pas qu’un simple dialoguiste et qu’il a toujours cherché à excéder les limites imposées par ses scénarios par une approche toute personnelle de la mise en scène. Pour ce qui est de son évolution, il est bon de rappeler qu’après une tentative ratée d’adaptation littéraire (un projet autour de L’Écume des jours de Vian), Blier a écrit tous ses films. L’écriture est donc primordiale chez lui et il ne faut pas oublier que Les Valseuses (1974) fut d’abord un roman et un grand succès de librairie. D’ailleurs, lorsqu’il évoque le sujet dans ses entretiens, le cinéaste considère que c’est à partir de Beau-père (1981) qu’il s’est vraiment intéressé aux questions de mise en scène (il juge d’ailleurs le film trop « sophistiqué » et regrette que le metteur en scène ait vampirisé l’auteur).
Pourtant, on perçoit dans ses œuvres précédentes un style qui n’appartient qu’à lui : un goût pour les ellipses qui dynamisent le récit, une manière d’enfermer les personnages dans un cadre rigide (baies vitrées, grilles…) et de jouer sur la présence inquiétante du hors-champ (dans Buffet froid, par exemple). À partir de Trop belle pour toi (1989), ses mises en scène deviennent de plus en plus morcelées, elliptiques et déconcertantes (glissements oniriques, film dans le film, télescopages spatio-temporels…). Mais elles participent toujours, à mon sens, d’une volonté de ne pas se cantonner à une simple illustration de scénarios très écrits.
« Blier déteste avant tout le conformisme et l’ennui. »
09:30 Publié dans Cinéma | Tags : les valseuses, trop belle pour toi, buffet froid, georges lautner, marest éditeur, beau-père, hitler connais pas, cruelle beauté, comme un torrent, notre histoire, depardieu, le comptoir, sylvain métafiot, vincent roussel, l’œuvre de bertrand blier est frappée d’oubli et d’indifférence, si j'étais un espion, la femme de mon pote, merci la vie, tenue de soirée, calmos, jean rochefort, jean-pierre marielle, combien du m'aimes, sexisme | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 08 mars 2021
Contes matois : Le Plaisir après la Peine

Manuscrit du XVe siècle rédigé en turc ottoman, Le Plaisir après la peine (Faradj ba’d al-shidda), fait partie — avec Les Ruses des femmes d’al-Hawrânî — des deux œuvres qui inspireront l’orientaliste François Pétis de La Croix, élève d’Antoine Galland, pour la rédaction de son livre Les Mille et Un Jours (5 volumes publiés entre 1710-1712). Fort de sa maîtrise de l’arabe, du persan, du turc et de l’arménien du fait de ses dix années passées en Orient, Pétis de La Croix rédigea également une version française du Zafarnameh (1425) ou Histoire de Tamerlan du poète persan Sharafaddin Ali Yazdi, qui fut publiée à titre posthume (4 volumes entre 1722 et 1723). Ce petit volume réunit ici trois contes sur les quarante-deux que compte le texte original.
Tout commence par la prédiction d’un astrologue à deux futurs parents inquiets : la fille qui naîtra sera une démone, rusée, intelligente mais terriblement roublarde. Le vieux savant avait raison : Dellé, c’est le nom de la jeune fille, devient orpheline dès sa naissance, commet de nombreux larcins une fois grande, trouve un mari aussi fourbe qu’elle et provoque, par ses filouteries répétées, la colère du cinquième calife abbasside Hārūn ar-Rašīd (« le bien guidé »). « Les ruses de Dellé » ouvre ainsi ce petit recueil d’histoires avec malice. Dellé et ses filles dépouillent un amoureux, piègent un ânier chez le dentiste, se moquent d’un vieil aveugle faisant l’aumône, détroussent le poète Abou Doulama, dérobent la corbeille de noces d’une fraîche mariée, se jouent du richard Ali Qouthni et volent même des voleurs en se faisant passer pour des goules. Tant et si bien que le commandeur des croyants s’en trouve désespéré : « Je ne sais quelles mesures prendre pour mettre un terme aux déprédations de cette exécrable créature ! » Et bien que la morale réprouve ses actes, impossible de ne pas trouver sympathiques les astucieuses manigances de cette coquine.
Construite comme une suite de récits enchâssés les uns dans les autres l’« Histoire de Taher et de ses frères » débute, elle, par les mésaventures de Taher, négociant à Basra, dépouillé par ses trois méchants parents alors qu’ils voguaient au large. La parole revient ensuite à son esclave, Qamr-el-Behar, qui raconte son enlèvement par le frère aîné de Taher et poursuivie par ses deux propres frères, souverains de l’île d’Anqa (le thème de la méchanceté des frères est récurrent). Après une escapade en mer, les deux amants sont capturés par des pirates et Qamr-el-Behar devient la prisonnière du roi de l’île d’Irem. Taher entreprend de la libérer des griffes du monarque en demandant l’aide de la sorcière Chemset qui commande aux animaux…
Le dernier récit narre, quant à lui, les aventures d’un architecte de la ville de Bim, en Kerman (Iran), de sa femme et des trois vizirs envieux du sultan de Guvachir. Chargé par le souverain de construire un kiosque et un palais, le bâtisseur accompli sa tâche avec la plus grande maîtrise, élevant le plus beau des imarets et recevant, en gage de son travail, les honneurs et les richesses de la cour. Mais les trois vizirs du sultan, jaloux et haineux, intriguent pour déchoir l’architecte de sa gloire en utilisant sa femme dans l’affaire. Mal leur en prendra car cette dernière retourne ingénieusement le piège contre eux… Récit à la visée édifiante, il sermonne que l’avidité et la calomnie ne sont jamais récompensées. En ce sens, les lamentations des trois vizirs déchus pourraient inspirer quelque humilité à nos puissants d’aujourd’hui : « La haine et l’envie ont causé notre perte ; où en sommes-nous arrivés ? Quelle situation est la nôtre ? À quoi nous servent notre richesse et notre haut rang ? »
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
mercredi, 24 février 2021
Déflagration spirituelle : Violence & Peace de Shinobu Kaze

Issu du gag-manga type Shonen Jump, Shinobu Kaze (de son vrai nom Tomoaki Saito) a longtemps été l’assistant de Gō Nagai (Devilman, Goldorak) avant de mettre son talent de dessinateur, au mitan des années 1970, au service de genres plus radicaux : science-fiction, horreur et polar. Il ne cache pas que ses trois principales références sont les films de Bruce Lee, les flics décomplexés de Seijun Suzuki et les bandes-dessinées rock’n roll de Philippe Druillet. Trop hermétique au public japonais, il collabora, dans les années 1980, aux magazines de comics américains Heavy Metal et Epic Illustrated.
Violence & Peace est une anthologie d’histoires courtes prenant le plus souvent place dans un futur apocalyptique où des individus paumés ou réfractaires parcourent des paysages dévastés, jonchés de cadavres, côtoyant des infrastructures cyclopéennes et des machines ultra sophistiquées et minutieusement détaillées. Le recueil s’ouvre sur le récit de l’homme le plus puissant du monde qui, armé de son sabre et de sa guitare électrique, part à la recherche d’une arme ultime « capable de faire disparaître l’angoisse elle-même » (Violence becomes tranquility)… Ailleurs, c’est un policier manchot qui lutte contre le programme totalitaire d’un gouvernement ayant décidé d’éradiquer toute violence sur terre en créant une force d’unité spéciale (L’annihilateur). Plus loin c’est une scientifique qui avale une pilule d’accélération et évite un avion de chasse en l’espace de 2,2 secondes (La femme supersonique). L’on identifie çà et là des thèmes bien connus de la SF et du cyperpunk : la fusion/répulsion du corps humain et de la machine, les expériences scientifiques incontrôlées, le basculement dans des réalités alternatives, la transmutation des genres sexuels, les dictatures planétaires, l’exploration des tréfonds de la conscience humaine… Mais Kaze est aussi prolixe dans le shojo horrifique et paranormal, « subvertissant les conventions du manga pour filles » comme le rappelle Léopold Dahan sans la postface. Que ce soit à travers la détresse d’un homme confronté à l’amour surnaturel de deux jumelles dont l’une d’elle prend possession du bébé de l’autre afin de l’éventrer de l’intérieur (Réincarnée par amour) ; ou la vengeance d’une médium qui va arracher le cœur d’un criminel sadique en voyageant dans les souvenirs de sa sœur (Mort du tueur en série).
Le plus fascinant reste néanmoins ses envolées mystiques totalement grandiloquentes, comme à la fin d’Écoute la voix de ton cœur, où après une longue période de destruction causée par des rêves étranges (les gens… explosent !), l’Humanité, sous l’égide d’anges et de guitaristes new-age, évolue en une conscience unique qui transcende le monde entier et vainc le mal dans un tourbillon d’énergie cosmique. Très en vogue dans les années 1980, cette cosmogonie futuriste se retrouvera dans des œuvres comme Akira de Katsuiro Otomo (1982), Ken le Survivant de Hara et Buronson (1983) ou Galaxy Express 999 de Leiji Matsumoto (1977). Explorant deux facettes fondamentales de l’être humain (littéralement Violence and Peace), Kaze se fait l’artisan du chaos pour mieux prêcher un idéal d’amour universel et un sursaut écologique. Les horreurs décrites sont bien souvent le résultat des guerres passées, tel ce spectre, mort lors des bombardements de Tokyo, qui hante le corps d’une lycéenne et pleure sa rage d’avoir été fauché dans sa jeunesse (Les larmes du spectre). Dans une autre histoire, un lycéen poussé au suicide se venge de ceux qui le harcelait en prenant possession de l’un d’eux et sème la mort autour de lui (Angel’s Eye). Ou c’est un miroir magique qui, à la manière du portrait de Dorian Gray, reflète l’état mental et la blessure sentimentale d’une jeune voyante.
Graphiquement, enfin, c’est d’une virtuosité folle. Sa maîtrise du dessin autant que son audace du découpage sont impressionnantes. Malgré le luxe de détails que peut contenir une seule case ou une double page, les séquences, bien que narrativement complexes, n’en demeure pas moins lisibles. Atteint d’une véritable emphase graphique, il construit ses planches comme un sculpteur taille dans le marbre, conférant à ses cases des formes géométriques recherchées et déroutantes, et dont l’originalité reflète bien souvent les états d’âme des personnages. Cette case déchirée par le tir d’un colt 45, par exemple, symbolise la crise et le désespoir d’un adolescent face à une vague délirante de suicides dans son collège (Le garçon au colt 45). La ligne du visage apaisé qui conclue l’histoire Heart and Steel semble, quant à elle, d’une perfection irréelle. Même apaisés, les méandres imaginaires de Shinobu Kaze sont un voyage sans retour.
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
10:11 Publié dans Littérature | Tags : futur apocalyptique, tomoaki saito, heart and steel, le comptoir, manga, sylvain métafiot, déflagration spirituelle, violence & peace, shinobu kaze | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 17 février 2021
Le mécano de la sociale : La Mécanique Lucas Belvaux de Louis Séguin et Quentin Mével

Dans le petit et dense essai qui précède le passionnant entretien avec Quentin Mével, Louis Séguin rappelle quelques traits caractéristiques du cinéma de Lucas Belvaux comme l’importance accordée à la parole (qu’elle soit dialoguée ou monologuée) mais aussi aux gestes silencieux dont la signification s’avère souvent cruciale dans l’avancement du récit. La mise en scène des corps porte ainsi l’histoire autant que le scénario : « Les films de Lucas Belvaux sont des théâtres, dont chaque personnage peut être tour à tour acteur ou spectateur ».
Ancrant ses récits dans des lieux qu’il connaît bien (les friches industrielles du Nord de la France, Charleroi, Le Havre, Liège et ses environs), jonglant aisément avec les genres (polar, comédie, drame… avec des réussites inégales), son point de vue se veut réaliste, observant d’un œil critique la misère sociale qui pousse au crime (La raison du plus faible), la démagogie politique qui prospère sur la peur (Chez Nous), la lâcheté ordinaire qui confronte la culpabilité personnelle au jugement de la société (38 Témoins), le fossé entre classes malgré l’amour (Pas son genre), la froide logique des intérêts bien compris (Rapt), les traumatismes de la guerre (Des hommes) ou encore le déclassement social, la culture ouvrière et les luttes syndicales. Chez Belvaux regarder la réalité en face c’est refuser le déni, porter un jugement, prendre parti, s’engager, quitte à rompre avec son entourage. D’où une dimension militante et éthique dans sa façon de filmer qui interroge les tourments moraux de personnages parfois antipathiques (grand patron, militants d’extrême droite…) permettant de comprendre tous les ressorts de l’intrigue. Il plane ainsi une sorte de déterminisme sur chacun d’eux, comme s’il était impossible d’échapper à leur condition sociale.
Ces thématiques se retrouvent dans l’entretien que le cinéaste a accordé à Quentin Mével et qui revisite, éléments biographiques à l’appui, toute sa filmographie de manière chronologique. L’on apprend ainsi que ses premiers pas en tant que réalisateur sur Parfois trop d’amour (1993) furent plus délicats quant à la direction d’acteurs que dans l’apprentissage de la caméra ou du découpage. Lui qui avait travaillé en tant qu’acteur pour Żuławski, Chabrol, Assayas ou Boisset avait eu le temps de s’instruire sur le tas des ficelles du métier mais il a dû apprendre, une fois derrière la caméra, à revendiquer et maintenir ses choix, parfois avec autorité. Belvaux se livre avec sincérité et, au détour de considérations sur les divers problèmes qu’entraîne la production d’un film (notamment sur sa trilogie mélangeant trois genres différents et tournée dans le désordre : Un couple épatant, Cavale et Après la vie en 2003), on apprend également que la rencontre entre Jean-Pierre Léaud et Ornella Muti sur Pour rire ! (1996) fut pour le moins surprenante et que c’est elle qui l’adouba en tant que metteur en scène. Il saisi l’occasion pour faire la différence entre la réalisation (« la technique, tu décides où mettre ta caméra, comment tu la fais bouger ») et la mise en scène (« le théâtre, comment tu fais bouger les acteurs dans un cadre ou un espace »). Côté technique il porte un amour particulier aux plans-séquence, aux travellings et au format scope. Côté personnages il mélange sans peine les univers de Jean-Pierre Melville, Ken Loach ou Fritz Lang. Et s’il passe un certain temps à se documenter avant de s’engager sur un projet, il n’hésite pas non plus – comme en témoigne ses derniers films – à imposer sa vision propre en adaptant des œuvres littéraires : La vie en jeu du Baron Empain, Est-ce ainsi que les femmes meurent de Didier Decoin, Pas son genre de Philippe Vilain, Le Bloc de Jérôme Leroy, Des hommes de Laurent Mauvignier. Pour toucher à la vérité il faut savoir prendre des libertés.
En somme, un ouvrage très instructif sur la fabrication d’un film (machine lourde et complexe s’il en est) et sur le parcours d’un cinéaste en perpétuel apprentissage : « Je me pensais de l’école de Jacques Rivette et John Cassavetes, des réalisateurs qui offrent beaucoup de place aux acteurs. En fait, je suis plus de celle de Claude Chabrol, Billy Wilder, Ernst Lubitsch ou François Truffaut, qui pensent beaucoup leurs films, en échafaudent méticuleusement la mécanique. »
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
15:46 Publié dans Cinéma | Tags : chez nous, la raison du plus faible, pas son genre, parfois trop d’amour, un couple épatant, cavale, rapt, après la vie, le mécano de la sociale, sylvain métafiot, le comptoir, la mécanique lucas belvaux, louis séguin, quentin mével | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 20 janvier 2021
Sébastien Bénédict : « Pour Miyazaki, le remède a toujours été dans le mal. »
Sébastien Bénédict est enseignant en lettres et critique de cinéma (Revue Carbone, anciennement Les Cahiers du cinéma, Chronic’art). Dans sa monographie consacrée au réalisateur Hayao Miyazaki (éditions Rouge Profond, 2018) il explore, « au gré du vent », cette multitude d’univers imaginaires qui, à la croisée de la science-fiction et du fantastique, de la fable écologique et de l’aventure épique, et portée par les forces élémentaires du rêve et de la métamorphose, agissent comme les révélateurs d’un Réel conflictuel et tragique mais toujours porteur d’espoir.
Le Comptoir : « Qu’il porte la guerre ou la caresse, [le vent] est de tous ses films, omniprésent et silencieux. » écrivez-vous dans les premières pages de votre ouvrage. Cette récurrence thématique chez Miyazaki semble accentuée par sa fascination pour les machines en tout genre et les avions en particulier qu’ils soient de conception réaliste ou rétro-futuriste. De quelle manière arrive-t-il à confronter ses idéaux pacifistes à la réalité d’une utilisation guerrière de la technologie ?
 Sébastien Bénédict : Il n’y a rien d’apaisé dans les films de Miyazaki, rien de stable. Tout y est une guerre permanente, entre des forces qui en s’opposant, forment un « équilibre » vacillant sans cesse, mais qui malgré tout fait tenir le monde. C’est pourquoi au sens large, je ne parlerais pas de « pacifisme » ; si idéal il y a, c’est pour lui le maintien de cet équilibre, tout en sachant qu’il met de la lutte en tout. La technologie sera ainsi pour lui le lieu même de cette ambivalence, dès sa première œuvre conséquente, la série Conan, le fils du futur (1978) : une dystopie post-apocalyptique, où l’état le plus avancé de la technologie peut en même temps asservir et sauver le monde.
Sébastien Bénédict : Il n’y a rien d’apaisé dans les films de Miyazaki, rien de stable. Tout y est une guerre permanente, entre des forces qui en s’opposant, forment un « équilibre » vacillant sans cesse, mais qui malgré tout fait tenir le monde. C’est pourquoi au sens large, je ne parlerais pas de « pacifisme » ; si idéal il y a, c’est pour lui le maintien de cet équilibre, tout en sachant qu’il met de la lutte en tout. La technologie sera ainsi pour lui le lieu même de cette ambivalence, dès sa première œuvre conséquente, la série Conan, le fils du futur (1978) : une dystopie post-apocalyptique, où l’état le plus avancé de la technologie peut en même temps asservir et sauver le monde.
Miyazaki est né de la guerre, l’année de Pearl Harbor, sa famille y a participé. Et puis comme tous ceux de sa génération, il est directement né d’Hiroshima, soit la première manifestation concrète d’une idée, jusqu’alors laissée à la théologie et aux peurs ancestrales, désormais incarnée dans le champ du réel : la fin du monde, pour la première fois, devient possible et non plus seulement redoutée. Et ce qui le permet, c’est précisément la technologie. On serait technophobe à moins, mais c’est elle, qui en aboutissant à cette capacité, redonne en définitive son prix au monde, le rend mortel en somme. Ce sera désormais un monde en guerre contre lui-même, soucieux de sa finitude. Pour Miyazaki, le remède a toujours été dans le mal. Même au risque de la guerre, faut-il renoncer au rêve de voler ? C’était le sujet du Vent se lève (2013).
12:07 Publié dans Cinéma | Tags : muska, kushana, dame eboshi, princesse mononoké, le vent se lève, le roi et l'oiseau, sylvain métafiot, porco rosso, le voyage de chihiro, conan, nausicaa, editions rouge profond, au gré du vent, le comptoir, sébastien bénédict : « pour miyazaki, le remède a toujours été dans le mal | Lien permanent | Commentaires (2)
lundi, 11 janvier 2021
Cimes cinéphiliques 2020
Qui succède à Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino au titre de meilleur film de l'année ? La réponse dans notre habituel top 10, suivi de son flop 10 tout aussi subjectif.
Au sommet cette année
1) Michel-Ange d’Andrey Konchalovsky : Gravé dans la roche.

2) Uncut Gems de Benny Safdie et Josh Safdie : Money Time.

3) Hotel by the River de Hong Sang-soo : Poétique de l'effacement.

4) Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret : Le principe de délicatesse.

5) Tommaso d’Abel Ferrara : La décomposition fantasmatique du couple.

12:18 Publié dans Cinéma | Tags : cimes cinéphiliques 2020, sylvain métafiot, top 10, flop 10, lucky strike, yong-hoon kim, la nuit venue, frédéric farrucci, peninsula, sang-ho yeon, radioactive, marjane satrapi, enragé, derrick borte, spenser confidential, peter berg, sortilège, ala eddine slim, the wretched, brett pierce et drew t. pierce, the gentlemen, guy ritchie, jojo rabbit, taika waititi, des hommes, jean-robert viallet et alice odiot, soul, pete docter, lux Æterna, gaspar noé, the king of staten island, judd apatow, swallow, carlo mirabella-davis, je veux juste en finir, charlie kaufman, malmkrog, cristi puiu, tommaso, abel ferrara, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, emmanuel mouret, hotel by the river, hong sang-soo, uncut gems, benny safdie et josh safdie, michel-ange, andrey konchalovsky | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 02 janvier 2021
Gravé dans la roche : Michel-Ange d’Andreï Konchalovsky

Sculpter des corps parfaits pour expier les démons de son âme. Tel semble être la ligne de crête qu’arpente le Michel-Ange de Konchalovsky, évitant ainsi de tomber dans l’écueil du biopic hagiographique et convenu, et concentrant plutôt son propos sur quelques années déterminantes de la vie de l’artiste florentin. Cette période tumultueuse de l’Italie de la Haute Renaissance où, entre crises politiques et succession pontificale, Michel-Ange se débat dans les rets du pouvoir afin de s’assurer une sécurité financière et une certaine autonomie artistique. Bénéficiant de la protection de la famille Della Rovere, sa position sociale devient incertaine lors de la mort du pape Jules II et du retour des Médicis qui installent Léon X au Vatican, chassant de force les Della Rovere de Rome. Afin d’honorer la commande de l’imposant tombeau de Jules II, il fait route vers Carrare afin d’y trouver le plus beau marbre d’Italie.
Arrivé à la carrière on touche au cœur du film. Jetant son dévolu sur un « monstre » (un bloc de marbre immaculé si massif que même les ouvriers en appréhendent le transport), Michel-Ange dévoile la démesure de ses obsessions artistiques en même temps que sa folie égoïste. Pour réaliser son chef d’œuvre, il n’hésite pas à mettre en danger la vie des carriers, à trahir ses amis et à s’attirer les foudres de ses mécènes. Car, au-delà du problème d’indépendance artistique vis-à-vis du pouvoir politique et d’une misère financière qui le suit comme un chien galeux, Michel-Ange est dépeint comme un exalté colérique, menteur et cynique. La prestation hallucinée Alberto Testone y est pour beaucoup. Sans doute que Konchalovsky a mis un peu de son propre orgueil dans ce portrait peu flatteur. Reste que, dans un même élan titanesque et insensé, le tour de force de la descente – réelle – du monstre de la carrière, rappelle celle – tout aussi réelle et éprouvante – de l’ascension du bateau dans le Fitzcarraldo de Werner Herzog (1982) en pleine forêt amazonienne.
Et ils sont rares et précieux ces rapports bruts à la matière, cette façon de scruter toute l’exigence technique que demande la pratique et le savoir-faire artisanal, loin du simple « élan créateur » vaporeux et impalpable qui sert de cliché aux portraits paresseux. Ces rouages de la création on les retrouvent, par exemple, dans Amadeus de Milos Forman (1984) lorsque, au seuil de la mort, Mozart dicte la partition du Requiem à Salieri ; ou dans Andreï Roublev d’Andreï Tarkovski (1969) lors de la fonte de la cloche géante de Souzdal. Konchalovsky, qui a participé au scénario de Roublev, saura se souvenir des larmes du jeune Boriska en entendant le son pur de la cloche lorsqu’il confronte Michel-Ange aux affres d’une dévotion religieuse contaminée par des visions cauchemardesques et qu’il tente de faire éclater dans ses œuvres. Seul Dante Alighieri, le divin Dante, demeure un phare pour le sculpteur tourmenté qui, en comparaison du génie du poète, s’enfoui de honte la tête sous le fumier. C’est une constante : bien que d’une arrogance volcanique, Michel-Ange n’a de cesse de déprécier son travail, ce n’est jamais fini, jamais parfait, il faut refaire les couleurs, le pape attendra, je vais tout détruire et tout refaire, si t’es pas content va bosser pour Raphaël, etc. Cette quête infinie de la perfection reflète son combat mystique intérieur : rendre gloire à Dieu c’est vaincre les tentations du Diable. Malgré la corruption qui le ronge, son être tout entier tend vers la beauté, à l’image de la main d’une jeune fille, frêle et nacrée, langoureusement pendante après un ébat amoureux.
Trop longtemps habitués à des biopics médiocres et ronflants – et par là enlaidissant les sujets auxquels ils croient rendre les honneurs – on en aurait presque oublié que le cinéma peut représenter la vie d’hommes illustres avec grâce et ferveur. Michel-Ange est de ceux-là.
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
15:31 Publié dans Cinéma | Tags : biopic, dante alighieri, alberto testone, della rovere, le comptoir, sylvain métafiot, gravé dans la roche, michel-ange, andreï konchalovsky | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 26 décembre 2020
Money Time : Uncut Gems de Benny Safdie et Josh Safdie

La dernière fois que nous étions allé rendre visite aux frères Safdie, Robert Patinson ne s’était pas remis de sa cuite post Twilight, errant avec son frère handicapé dans les artères crades d’un New-York qui n’aurait pas subit la politique hygiéniste de Rudolph Giuliani, à la recherche de billets faciles et d’un rêve américain imaginaire (Good Time, 2017). Entamée avec The Pleasure of Being Robbed (2009) et prolongée avec Mad love in New-York (2014), les frères terribles du cinéma indépendant américain poursuivent ainsi l’exploration nerveuse de la « grosse pomme » comme un ver gourmand se repaît d’un fruit pourri avec ce survolté Uncut Gems.
Soit Howard Ratner, joaillier juif du Midtown Manhattan, magouilleur, infidèle, hypocondriaque et accro aux paris sur les matchs NBA. Lorsqu’une opale non taillée arrive d’Ethiopie, Howard voit l’occasion idéale de rembourser toutes ses dettes en tentant une arnaque aux enchères. Mais ses créanciers sont du genre dubitatif et seraient plutôt partisans de lui casser les rotules à la barre à mine. Le nombre de ses ennemis s’accumulant au fil de ses dépenses… La première bonne idée de Bennie et Josh Safdie fut de ressusciter Adam Sandler – acteur plus habitués aux Razzie Awards qu’au tapis rouge des Oscars – en lui offrant ce qui restera peut-être comme le rôle le plus marquant de sa carrière. Howard est propulsé d’une dette de jeu à une embrouille avec un client, à un nouveau crédit, à un pari risqué, à une dette supplémentaire, etc. Exaspérant, il n’en demeure pas moins attachant, notamment dans cette croyance un peu folle que la chance va enfin lui sourire. Le verbe scorsesien vole haut et fort chez les frères. Pas étonnant que l’ancien gamin de Little Italy ait produit le film quand on voit les ressemblances avec l’univers trépidant des Affranchis (1990), Mean Streets (1973) ou Le Loup de Wall Street (2013). Mais cette explosion de logorrhée verbale, loin de résonner dans le vide, constitue le moteur d’Howard, son carburant auto-généré. Si le silence est d’or le phrasé mitraillette d’Howard a l’éclat des diamants tape à l’œil qui viennent orner les grillz et autres médaillons des rappeurs bling-bling et autres stars du showbiz en manque de lustre.
Cette énergie démente qui parcourt tout le film intensifie les obsessions ludiques et dramatiques des frères Safdie. Suivre Howard à la trace s’enliser et essayer de se dépêtrer de toutes ses combines pendant plus de deux heures est épuisant. Mais terriblement drôle et excitant. Porté par la bande-originale électro stratosphérique de Daniel Lopatin et la photographie iridescente de Darius Khondji, le polar fiévreux des Safdie – à la manière des films de genre d’Abel Ferrara – ne tient pas en place, conférant aux rares moments d’accalmie l’élan nécessaire pour repartir à pleine vitesse. De là cette impression que l’hystérie contamine tous les protagonistes du Diamond District, même les plus éloignés de l’œil du cyclone : la frénésie chaotique d’Howard entraînant une véritable tempête d’emmerdements dans son sillon. Loser pathétique qui se voudrait le roi du monde, Howard est comme un gosse irresponsable qui refuserait les règles du monde réel pour s’inventer un rôle à la hauteur de ses ambitions matérialistes. Son excentricité masque pourtant un profond besoin d’amour et une quête spirituelle. Et c’est une inconscience toute enfantine qui déterminera son pari le plus décisif. Pour lui, le jeu est à l’image de sa vie : un mouvement perpétuel hors de la réalité mais qui (en apparence) le maintien en vie. Jouer c’est défier le destin en lui faisant son plus beau sourire.
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
13:14 Publié dans Cinéma | Tags : darius khondji, nba, daniel lopatin, adam sandler, le comptoir, sylvain métafiot, new-york, money time, uncut gems, benny safdie et josh safdie | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 01 décembre 2020
Les artisans conteurs : Un monde parfait selon Ghibli d'Alexandre Mathis

Fondé en 1985 par Hayao Miyazaki et Isao Takahata, le studio Ghibli est depuis une bonne trentaine d’années LA référence mondiale en matière d’animation japonaise. Au point de contester sur leur terrain des géants comme Disney ou Pixar. La création du studio marqua la volonté d’indépendance des deux amis, après de longues années à travailler comme assistants-réalisateurs sur des productions dont ils n’avaient que peu de contrôle. Pourtant, si Ghibli a pu atteindre de telles cimes cela provient – avant même l’indéniable qualité graphique de l’animation – de l’incroyable puissance narrative des histoires contenues dans ses œuvres. L’ouvrage d’Alexandre Mathis analyse ainsi, en une dizaine de chapitres finement construits, les différentes thématiques qui insufflent cette énergie si particulière aux films du studio japonais.
On trouve notamment la mise en avant récurrente d’héroïnes déterminées, plus ou moins puissantes, mais jamais dans l’ombre des hommes. Les princesses sont avant tout définies par leurs actes (ceux de combattantes, telles Nausicaä ou Mononoké) et certaines, comme Kaguya (Le Conte de la princesse Kaguya, 2013), se révoltent contre leur condition imposée qui les empêchent de vivre selon leurs désirs. Kaguya est victime d’une pression masculine la forçant à se marier, tout comme la jeune Haru dans Le Royaume des chats (2002) ; mais contrairement à Taeko qui, dans Souvenirs goutte à goutte (1991), choisira la vie familiale à la campagne plutôt qu’une carrière en ville. Dans Porco Rosso (1992), c’est grâce à ses talents d’ingénieur que Fiona, avec l’aide des femmes de sa famille, reconstruit l’avion du héros. C’est toujours la libre volonté qui prime.
Mais les films Ghibli regorgent également d’enfants se lançant, sans crainte, à corps perdus à l’aventure (Satsuki et Mei, Sôsuké et Ponyo), émerveillés de côtoyer des créatures magiques – Kamis, Yõkai et autres tanukis farceurs sont légions dans Le Voyage de Chihiro (2001), Princesse Mononoké (1997) ou Pompoko (1994). Une acception candide du monde fantastique qui devient contagieuse : « Parce que les personnages deviennent un peu plus comme nous, nous avons un peu plus envie de devenir comme eux. » Cette sensation de « vivre dans le film » – que l’on ressent par exemple devant Mes voisins les Yamada (1999) – porte un nom : le Rinjõkan, le « sentiment d’être sur place ». Chez Takahata, on trouve également le Jitsuzaikan, la « sensation du réel ». Voilà d’ailleurs un des points qui différencie les films de Miyazaki de ceux de Takahata : le premier ancre ses aventures dans des univers résolument imaginaires tout en montrant le quotidien des personnages et en s’inspirant de lieux existants (la vieille ville de Stockholm, la mer adriatique, le village taïwanais de Juifen, Colmar…) ; alors que Takahata raconte des histoires se déroulant principalement dans le Japon contemporain, agrémentées de nuances de magies. Ces deux visions opposées du réel n’en demeure pas moins complémentaires quant à l’identité du studio que l’on pourrait définir comme un « merveilleux réaliste ». À noter que Miyazaki possède un allié de poids en la personne de Joe Hisaishi, conférant un lyrisme flamboyant à toutes ses œuvres depuis Nausicaä (1984).
Bien qu’admirateurs des techniques artisanales, les deux animateurs phares du studio partagent néanmoins le même dégoût de la guerre sous toutes ses formes et des méfaits industriels qui ravagent la planète. L’horreur des combats est explicite dans Le Château ambulant (2004), et celui d’un pouvoir militaire devenu fou dans Le Château dans le ciel (1986). Passionné d’aéronautique « Miyazaki rêve d’avions avec un idéal de pacifiste convaincu », comme en témoigne l’aviateur Porco qui « préfère être cochon que fasciste », Nausicaä qui survole les batailles avec son élégant planeur, ou l’aveuglement créatif de Jiro dans Le vent se lève (2013), bientôt rattrapé par la réalité du conflit international. Mais c’est peut-être Le Tombeau des lucioles (1988) qui montre de manière la plus frontale et cruelle l’abomination de la guerre à travers la destruction des villes, des familles et des innocents. Lutter contre la destruction du monde va également de pair avec la préservation de la nature. Si cette dernière semble hostile au premier contact elle ne fait que réagir aux agressions premières des hommes : les ômus de Nausicaä, les tanukis de Pompoko ou les Tatari-gami de Mononoké se révoltent contre la destruction de leur écosystème. Pourtant, malgré la violence et la complexité des relations entre l’homme et la nature (comme l’illustre le fameux personnage de Dame Eboshi, contrainte de déforester pour protéger les siens), il y a toujours une lueur d’espoir chez Ghibli, permettant à chacun de trouver sa place : « Si les humains et la nature ne peuvent pas spontanément vivre pleinement en harmonie, c’est en pariant sur l’intelligence de quelques-uns qu’un fragile équilibre peut exister. »
Sylvain Métafiot
Article initialement publié sur Le Comptoir
09:15 Publié dans Cinéma | Tags : hayao miyazaki, isao takahata, sylvain métafiot, le comptoir, les artisans conteurs, un monde parfait selon ghibli, alexandre mathis | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 23 novembre 2020
La mystique appelle la mécanique : La petite peur du vingtième siècle d'Emmanuel Mounier